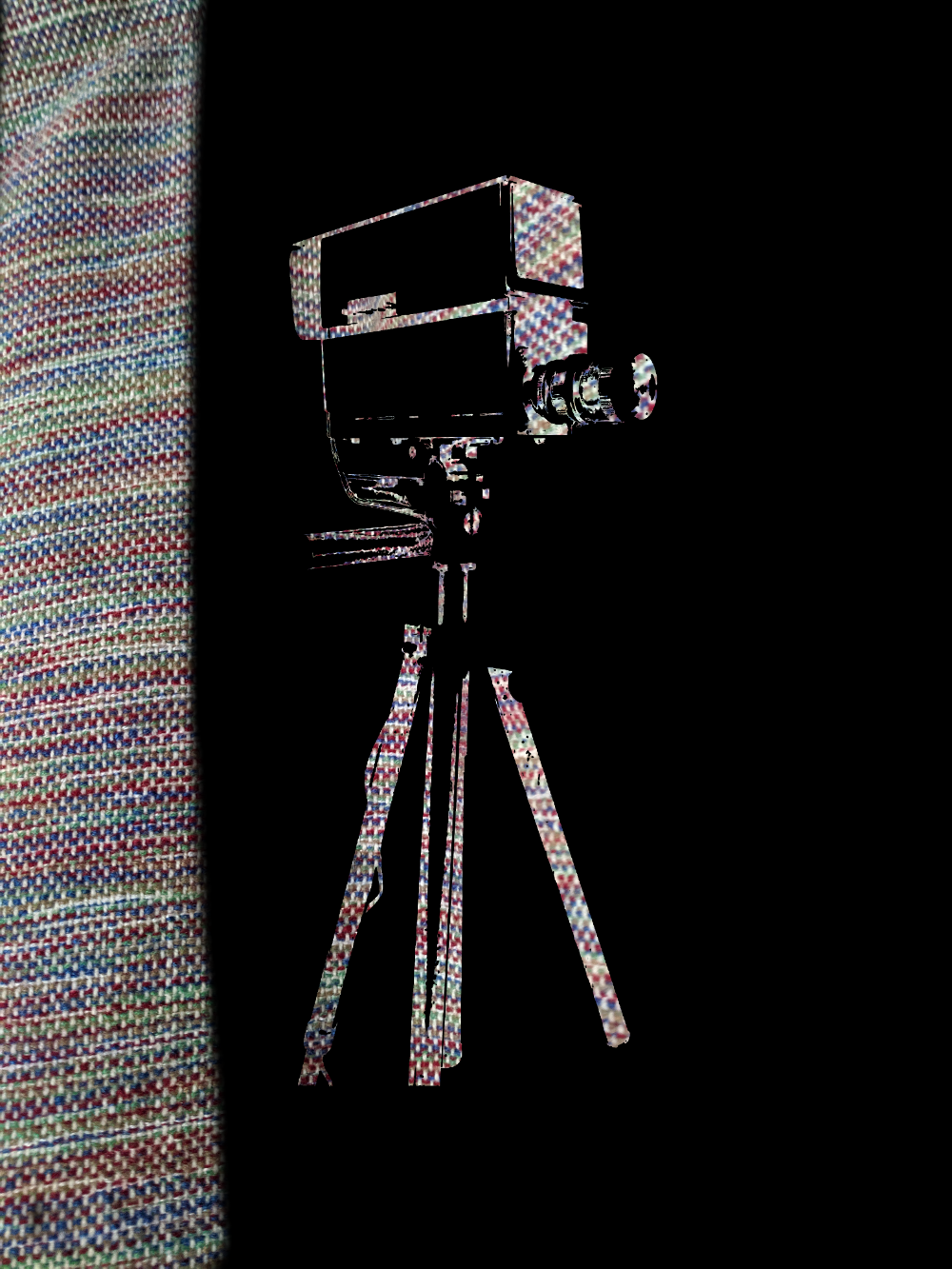Une minute en ondes
SÉBASTIEN HUOT
Illustration : Catherine Lefrançois
« Viens me rejoindre à Donnacona », me dit Robert en m’indiquant le chemin. Il a passé la journée dans le parc où la Jacques-Cartier se jette dans le fleuve. « Tu prendras ma relève. Je t’attends. » Robert fait de 9h à 17h et termine bientôt son quart, mais il m’attend à Donnacona avant de partir.
Été 2001.
Mon premier été comme caméraman pour les nouvelles. J’apprends le métier dans les quarts de travail que les vieux laissent aux débutants : très tôt ou très tard la fin de semaine; ou en fin de soirée la semaine. Aujourd’hui, en ce samedi chaud de juillet, je fais de 17 h à 1 h du matin. Un quart de travail sans journaliste, en patrouille pour les faits divers. Ce que j’aime le moins…
Avant de venir au travail, j’ai passé l’après-midi à me baigner dans la rivière derrière chez moi. Le soleil était chaud, l’eau était froide, j’y serais resté…
Le parc où Robert m’attend est facile à trouver : depuis la 138, on voit de loin les deux voitures de police. En me stationnant, je découvre aussi la camionnette du superviseur de la SQ avec ses multiples antennes, une ambulance et un Jeep de plongeurs.
Je sors le trépied et la caméra, je « fais mon blanc » sur le camion : 5600 Kelvin. Le ciel est découvert, le soleil ne descend pas encore. L’ajustement devrait être bon pour deux heures avant que la lumière change. Je prends mon sac, j’y mets des batteries, le micro, les cassettes – on travaillait encore sur cassette en 2001 – et je rejoins Robert, en passant sous le ruban jaune « do not cross/ne pas traverser » que la police a tendu entre deux arbres.
« Il y a un noyé », me dit tout de suite Robert. « Il se baignait dans la rivière et il a disparu. Il faut attendre que la police sorte le corps, que l’ambulance l’embarque et s’en aille. Tu filmes tout ça et tu t’en vas. Ça peut être dans deux minutes ou dans quatre heures. »
Il attend que je sois prêt avant de désinstaller sa caméra, il roule ses fils, plie son trépied et se dirige vers son camion. Quand tout est rangé, il revient me voir avec d’autres instructions.
« Les passants doivent rester derrière le ruban jaune. Mais les policiers permettent aux caméramans de venir jusqu’ici. » Il pointe un arbre à ma gauche, puis un rocher vers la droite, directement sur la rive de la Jacques-Cartier. « Imagine une ligne entre l’érable là-bas, et le rocher brun : c’est la limite qu’on ne peut pas dépasser. »
« – Nous sommes plusieurs caméramans?
– Vous êtes deux. » Il pointe un trépied et une caméra installés à quelques pieds à ma gauche. « Toi et un gars d’un autre réseau. Les policiers ont localisé le corps sous l’eau, mais il est coincé sous un surplomb rocheux. Difficile à sortir. Si t’as des questions, tu demandes au sergent Lemire. Le chauve là-bas. La police nous parle, mais ne fera pas de conférence de presse. »
« La police nous parle », ça signifie qu’ils collaborent avec nous. Qu’ils nous informent de l’avancement des recherches et s’assurent qu’on puisse faire notre travail. Ce n’est pas toujours le cas. Parfois, ils se méfient et nous gardent dans le flou, lors d’arrestations par exemple, ou quand ils ont des témoins à protéger. Mais aujourd’hui ils n’ont rien à cacher : ce n’est qu’un accident avec mort d’homme; un accident bête, mais qui demande l’intervention de la police.
… avec mort d’homme, quand même…
Robert regarde autour, la rivière, le fleuve, les cailloux créant les rapides, le soleil encore fort qui n’a pas commencé à se coucher… « C’est beau ici. Faudrait revenir faire des beauty shots. » Puis son regard se porte vers le sud, vers l’endroit où les ambulanciers préparent leur civière. Il fronce les sourcils légèrement, je vois ses lèvres se tendre. Il soupire. « Je n’aime pas filmer des accidents. »
« Moi non plus. » Je le pense, même si c’est mon premier accident. On se salue. Il s’éloigne, retraverse le ruban jaune « do not cross », monte dans son camion et démarre. Je dépose mon sac entre les pattes du trépied, place sur le dessus, prête, une batterie de rechange, et j’attends.
J’aime bien Robert. Parmi les caméramans avec qui je travaille, c’est l’un des rares que je qualifierais d’artiste. Il crée ses images comme un peintre ou un photographe, débusquant la lumière et la faisant éclater où personne d’autre ne l’aurait vue. Quand j’ai commencé, le patron m’a jumelé avec lui pendant quatre semaines : il avait des problèmes de dos, j’avais besoin d’apprendre. J’ai appris énormément. Et je suis devenu l’ami de cet homme réservé et timide qui ne parle que lorsque nous sommes seuls. Je sais maintenant reconnaître ses demi-sourires lorsqu’il tourne ce qu’il aime; ou à l’inverse, dans les infimes mouvements de ses sourcils, je décode son dépit quand on l’envoie sur ce qu’il appelle de la « saucisse » : des sujets inutiles, juste pour remplir le bulletin de nouvelles.
Robert a raison. L’endroit est beau. J’en profite pour filmer quelques paysages. Un jeu que je fais quand j’attends : le « défi des trois images ». Sans déplacer ma caméra, juste en pivotant sur le trépied, je dois trouver trois images différentes qui ne soient pas des variations l’une de l’autre. Facile dans cette journée de juillet au soleil lourd : les remous de la rivière entre les arbres, le chat furtif dans les herbages, les carouges en patrouille, les hirondelles louvoyant, les papillons monarques, les abeilles, les grillons, tout semble vibrant et fébrile, enveloppé de la même lumière chaude et effervescente.
Et le cadavre? Le noyé dont on tente d’extraire le corps de sous un surplomb rocheux, quel reflet aura sur lui la lumière chaude et effervescente?
« C’t’un Mexicain. » Le caméraman de l’autre réseau s’approche.
« Un Mexicain? » Je ne connais pas ce caméraman. Mais j’imagine qu’il existe une confrérie de métier, qui me force à lui parler?
« Ben oui. Un Mexicain. Ils viennent ici l’été, cueillir des fraises ou des tomates pour les agriculteurs, pis en septembre ils retournent au Mexique les poches pleines de cash. »
Tiens, ça m’étonnerait qu’ils retournent chez eux les poches pleines de cash. Quelque chose dans l’ALENA, dans la dynamique des relations de travail, dans la culture du partage qui est encore à améliorer, me laisse plutôt croire qu’ils font à peine leurs frais – déplacement, logement, nourriture, etc. – en cueillant nos fraises et nos tomates. Mais je me retiens de répondre et je continue de tourner mes paysages. De toute façon, il ne parle pas pour que je lui réponde, il parle seulement pour dire. Je comprends le besoin de silence de Robert, ses gestes lents, ses retenues qui surprennent les collègues : il s’isole et se protège.
« – Ben oui. Eux les Mexicains, ça les dérange pas la chaleur. Ils peuvent cueillir en plein soleil même quand nous on n’est pu capables.
– Voyons donc! » La surprise me fait sortir les yeux du viseur. « La chaleur, ça les dérange autant que toi.
– Ben oui », qu’il répète – toutes ses phrases commencent par Ben oui. « Ben oui. Ça les dérange un peu c’est sûr. Mais pas comme nous. »
Je pense qu’il ressentait sûrement la chaleur, le Mexicain, sinon pourquoi aurait-il eu besoin d’aller se rafraîchir dans les eaux tumultueuses d’une rivière pleine de rapides? Je pense qu’au milieu de son champ de tomates, à tailler des plants et à sarcler des mauvaises herbes en plein soleil, il souffrait autant de la chaleur que son contremaître québécois bien à l’ombre dans son Jeep climatisé, qui ouvrait parfois la fenêtre pour lui donner des consignes, profitant que le Mexicain ne parlait pas français pour les emballer d’impolitesse. Il souffrait autant de la chaleur que moi qui me suis aussi baigné tout l’après-midi dans une rivière, derrière chez moi, une rivière calme et sans rapide, pleine de baigneurs, dont je connais tous les méandres. Mais peut-être que si j’étais venu jusqu’ici pour travailler dans des champs de tomates, peut-être que si je n’avais rien trouvé d’autre pour me rafraîchir que les flots traîtres de la Jacques-Cartier, et si je n’avais parlé que l’espagnol, peut-être que je n’aurais pas compris les panneaux avec les mises en garde : « Baignade interdite. Rivière dangereuse »; peut-être qu’alors le rapide sournois m’aurait emporté, moi aussi, et que je serais maintenant coincé sous un surplomb rocheux d’où deux plongeurs de la SQ essaieraient de m’extraire…
Soudain, ça bouge du côté des plongeurs. Ben-Oui se tait et se colle l’œil au viseur. Moi aussi. On part les caméras.
Zoom in/foyer/iris/record. La scène se précise instantanément dans nos viseurs. Un plongeur remonte à la surface et embarque sur le Zodiac au milieu de la rivière. Le policier aux commandes du dinghy l’aide, puis ensemble, ils cherchent dans un coffre et en sortent une sangle de caoutchouc. Le plongeur se rajuste puis retourne à l’eau. Nos caméras tournent encore une minute. Nous restons vigilants, mais rien n’arrive. Alors, sans nous concerter, en accord professionnellement, nous éteignons les machines, et nous reprenons notre veille. La scène, anodine, est enregistrée sur la cassette. Elle pourra servir au montage. Le collègue me regarde, sourire en coin en hochant la tête. Ça me met mal à l’aise. Je me sens obligé de parler.
« Fausse alerte! » que je dis.
« Ben oui. Fausse alerte. »
Le sergent Lemire s’approche vers nous. « Donc nous ne ferons pas de conférence de presse, mais je vous confirme qu’un homme de 24 ans est mort noyé après avoir été emporté par les rapides. »
Le collègue et moi prenons des notes, pour nos rédacteurs respectifs.
« On sait c’est qui? » je demande.
« C’est un travailleur agricole mexicain engagé par les producteurs de maïs de la région. Il était au Québec depuis la fin juin et il devait retourner chez lui dans huit jours. Le consulat a été averti, maintenant leurs gens vont prendre la relève pour rapatrier le corps… »
Je ne l’écoute plus. Je pense au mort : un « travailleur mexicain ». Il n’a pas de nom. Si c’était Geneviève Thibodeau, la quincaillière du coin, ou Kevin Leroy-Bourdages, un adolescent des alentours, son nom nous serait relayé par le policier, par les journalistes, par les médias, par les rapports du coroner… Mais un travailleur mexicain qui allait retourner « chez lui » dans huit jours, ça n’a pas de nom.
« Les plongeurs ont eu de la difficulté à le localiser à cause des rapides et des rochers. » Le sergent nous indique une plage, entre le Zodiac sur l’eau et l’ambulance qui s’est approchée tant qu’elle pouvait sur le gazon. « Ça vous va s’il sort là? Le soleil, l’angle de prise de vue, c’est bon? » Nous faisons oui de la tête. Le sergent Lemire est efficace, sérieux, plutôt sympathique. Pourquoi ne nous aiderait-il pas? Il fait son métier, et il s’assure que nous puissions faire le nôtre du mieux possible.
… Et je me mets à réfléchir à ce métier que je fais depuis à peine quelques mois, ce métier pour lequel j’ai étudié, espéré, réussi enfin à me tailler une place dans la grande ligue, et soudain ce métier me laisse perplexe : voici donc mon emploi du temps des quarante prochaines années : perdre des après-midi à attendre des cadavres de noyés, pour que les nouvelles puissent remplir une minute en ondes. Quand j’étudiais, c’est pas ce que j’avais en tête…
Mais est-ce que j’ai le droit de me plaindre? Ce n’est pas moi la victime. Le travailleur mexicain, lui, qu’est-ce qu’il avait en tête en venant ici? Sûrement pas de se noyer accidentellement loin de chez lui, huit jours avant de retourner auprès de sa famille, de ses amis, de ses amours. Sûrement qu’il aurait préféré les cueillir au Mexique, les maïs. Ou peut-être qu’il rêvait d’autre chose : de devenir lui aussi caméraman? Ou comptable? Ou neurologue? Pompier? Écrivain? Astronaute? Électricien?… Il rêvait sûrement de mieux, mais quelque chose – dans l’ALENA, dans la dynamique des relations de travail, dans le « tous les hommes naissent égaux » qui est encore à améliorer – l’a forcé à venir tailler des blés d’Inde à 2000 km de chez lui.
Mon travail est peut-être absurde; le sien était injuste.
« Selon l’agent en poste sur le Zodiac, les plongeurs auraient réussi à décoincer le corps. » Le sergent Lemire pointe encore en direction de la plage. « Ils devraient le sortir d’ici 15 à 20 minutes. »
Nous remercions le policier qui retourne vers la camionnette d’où il dirige les opérations. L’autre caméraman et moi révisons pour une centième fois notre matériel : batterie, audio, cassette… Tout va bien. Il est 19 h 30. Mesure de lumière : l’intensité a baissé un peu, la couleur beaucoup : on est maintenant dans la zone critique, entre 5000 et 4000 Kelvin. Il faudra être vigilant.
« T’as combien? » me demande le collègue
« – Quatre mille huit cents. C’est la première fois que ça change depuis que je suis arrivé à cinq heures.
– Ben oui, maudit chanceux! Cinq heures! Moi, j’attends ici depuis midi. J’ai hâte qu’ils le sortent, l’écrapou! »
Un « écrapou », c’est la victime d’un accident. Étymologiquement, j’imagine que ça vient d’écrapouti. J’entends l’expression parfois dans le métier.
La maladie professionnelle du journalisme, c’est le cynisme. J’ai souvent vu des chefs de pupitre, dépités devant leur bulletin tiède, espérer un gros fait divers; ou des reporters se réjouir en allant couvrir un triple meurtre, heureux de la grosse histoire qui vient de leur tomber dessus. Quelles que soient la tristesse ou la désolation de ce qu’on couvre, je n’en ai jamais vu pleurer! Certains collègues parlent d’un moyen de défense, d’une distanciation devant la douleur. À côtoyer quotidiennement des accidents, on deviendrait supposément insensible. Pourtant, chez les ambulanciers que je croise, qui voient autrement plus de douleur, et de beaucoup plus près, je n’ai jamais vu ce cynisme, je n’ai jamais entendu parler d’un « écrapou ».
Mon téléphone sonne.
« Oui allô? »
C’est Montréal, la tête de réseau. Le noyé les intéresse.
« – Ils l’ont sorti?
– Non pas encore. Les policiers parlent d’une quinzaine de minutes.
– D’accord. Dès que tu l’as, retourne à la station, monte un 40 secondes et alimente-le-nous, svp. On est pauvres en nouvelles ce soir. On va le mettre au 22 h. »
Et le travailleur mexicain sans nom, dont personne ne se préoccupe vraiment en cette chaude journée de juillet sans nouvelles, vient d’être promu « d’intérêt national »…
Derrière nous, dans le parc, les curieux commencent à se rassembler de l’autre côté du ruban jaune de la police.
« Ffffuuiiitt! Les gars! » L’un d’eux siffle pour avoir notre attention. Je mets mes écouteurs et m’absorbe dans des faux tests de son. J’ai pas le cœur à ce genre de relations publiques. J’ai jamais le cœur à ce genre de relations publiques. Monsieur Ben-Oui, devinant un interlocuteur avec plus de répondant que moi-même, me fait signe de jeter un œil sur son équipement pendant une minute, et se dirige vers le siffleux.
Je filme un peu les curieux, pour des « plans de coupe ». Certains se hissent sur la pointe des pieds ou s’étirent la tête, d’autres ont même des jumelles pour mieux voir l’action – tiens, moi qui ai le privilège de la regarder de près, je préférerais ne pas la voir! « Allez-vous-en », je voudrais leur dire.
Je suis sincère : il n’y a vraiment rien à voir ici! Ce sera plus beau à la TV. Pas seulement parce qu’on est 30 mètres plus près de l’action, pas seulement parce qu’on a le respect des policiers qui nous feront signe quand les plongeurs vont revenir, mais surtout parce qu’il ne va RIEN se passer ici.
Tout simplement!
Une civière avec un sac opaque va être transportée depuis un Zodiac vers une ambulance. Puis l’ambulance va partir. La scène va durer deux furtives minutes, maximum.
Alors qu’à la TV, dans les 20 secondes intenses où on parlera de l’accident, vous verrez des bonnes images avec un soleil bien calibré dans les meilleurs angles possible, choisis avec l’accord de la police. Le montage sera dynamique et s’accordera parfaitement à la voix sérieuse et empathique du journaliste, qui vous donnera l’impression que quelque chose de long, de grand, de marquant s’est déroulé ici aujourd’hui.
Monsieur Ben-Oui revient : « La foule est curieuse. Je leur ai dit ce que je savais. »
À cette époque, les caméras, à moitié analogiques, étaient capricieuses avec les couleurs. Je débutais. J’étais incertain et craintif. Alors je combattais l’insécurité en « faisant mon blanc » sans arrêt.
Je suis à 4300 Kelvin quand le sergent Lemire sort de la camionnette et nous fait un grand geste : les plongeurs reviennent. Soudain, pour le collègue comme pour moi, les réflexes s’enclenchent. Zoom in sur la plage. Foyer. Iris. Record. Et tout déboule comme j’avais prévu : le Zodiac accoste en remorquant derrière lui un grand sac que les deux plongeurs encore dans l’eau maintiennent pour l’empêcher de couler. Les deux ambulanciers s’approchent et le hissent sur une civière qu’ils roulent ensuite jusqu’à l’ambulance. La partie supérieure de la civière avec le sac opaque contenant le cadavre glisse par la porte arrière sur le lit dans le véhicule. Les ambulanciers l’attachent puis ressortent plier les roues de la civière qu’ils rangent dans un autre compartiment avant de refermer les portes, de monter à l’avant et de démarrer. L’ambulance s’éloigne, les gyrophares balaient la torpeur du début de soirée, mais les sirènes restent silencieuses parce qu’après tout, il n’y a plus d’urgence.
La scène, depuis l’arrivée des plongeurs, n’a même pas duré deux minutes.
J’ai ce que je voulais :
Gros plan du sac qui sort de l’eau, qui se fait hisser sur la civière.
Zoom out : plan large de la civière qui roule vers l’ambulance, découvrant du même coup le décor.
Zoom in : gros plan de la civière qui entre dans l’ambulance.
Demi-zoom out : plan moyen des portes qui ferment et des ambulanciers qui entrent à l’avant.
Complet zoom out : plan large où on voit les gyrophares commencés à tourner et l’ambulance, aidée par les policiers, se frayer un chemin à travers les curieux. Et ça se termine quand l’ambulance disparaît sur la 138.
Le montage sera facile. En commençant avec le plan du plongeur qui est sorti de la rivière plus tôt, je n’aurai même pas besoin de mes plans de curieux pour atteindre les 40 secondes.
Montréal va être contente.
Le travailleur mexicain aura, d’un océan à l’autre, cette épitaphe anonyme, tournée, montée par mes soins. Mon travail est peut-être absurde, mais ce soir, je le fais en songeant à lui.
Monsieur Ben-Oui ramasse son équipement plus vite que moi. Il garroche ses fils dans le derrière de sa camionnette sans prendre le temps de les rouler. Il plie son trépied clic-clac en trois secondes, range sa caméra sans en sortir la cassette – peut-être filme-t-il deux sujets sur un même ruban? J’arrive à peine à mon camion quand il démarre le sien. Par la vitre ouverte, il m’envoie la main et lance :
« OK salut! On se revoit au prochain écrapou. »
Je lève la main à mon tour, je hausse les sourcils sans sourire, et je dis simplement :
« Ben oui. »