Trop vite
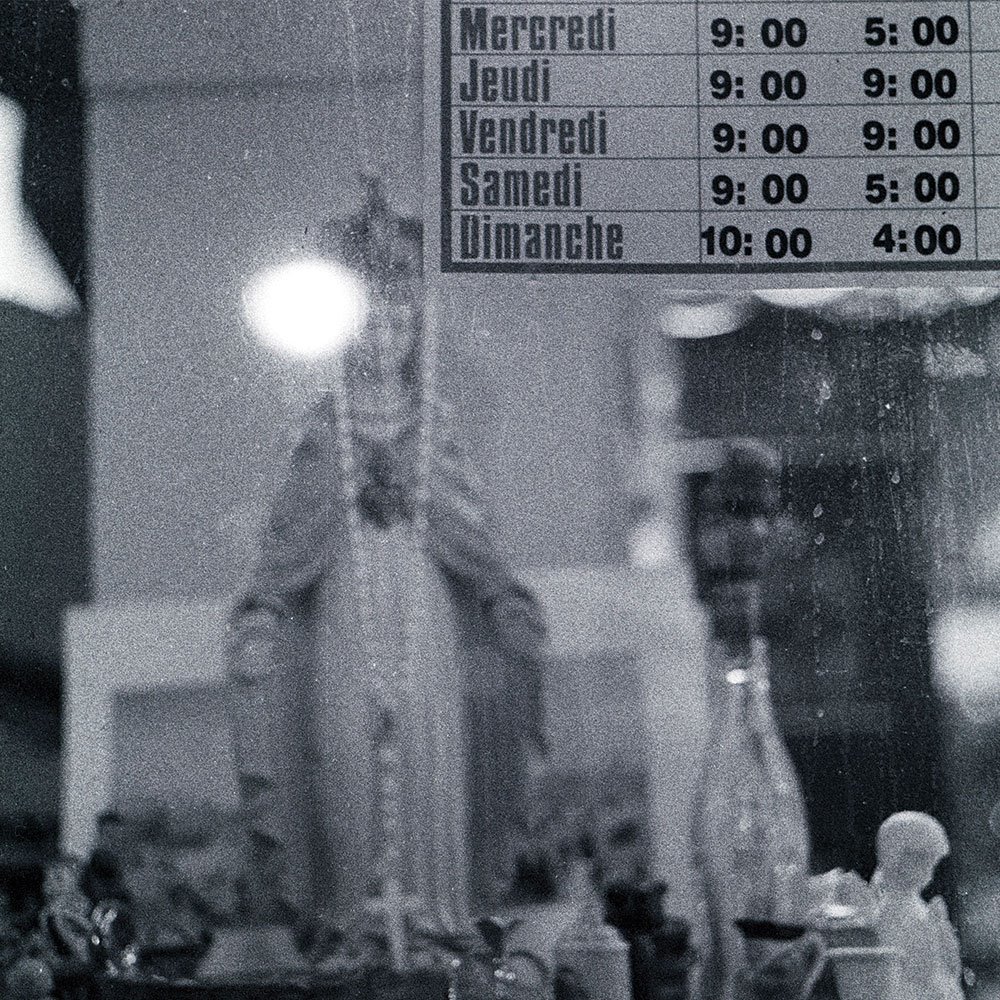 TYPHAINE LECLERC-SOBRY
TYPHAINE LECLERC-SOBRY
Illustration: Anne-Christine Guy
vite, faut se lever!
vite, préparer le sac, plier les couches, préparer des vêtements de rechange, manger une bouchée et demie
vite, guider la main droite dans la manche droite, la main gauche dans la manche gauche
vite, commencer la journée
vite, faut que j’avance
vite, faut que je fasse avancer
mes projets, mes souhaits
que je produise, que je reproduise
vite!
on est pressé.e.s mon amour!
cours plus vite, on a du monde à rattraper!
cours, ma petite licorne!
vite, même écrire
faut que ça aille vite
tchop! tchop!
perds pas trop de temps
des fois
la lenteur du deuil et de l’absence me manque
la lenteur du temps où j’avais le temps
de pleurer et de penser
des fois
je cherche d’où ça vient
ce besoin d’aller vite
de valoriser le fait qu’on est dans l’jus.
*****
Je cherche et je ne trouve pas.
Je cherche et je continue de dire que je suis débordée.
J’imagine que ça me permet de me sentir importante, sollicitée. Comme pour les likes et les commentaires que je collectionne sans l’avouer, je me fais croire que les précieuses minutes qu’il me manque sont autant de preuves qu’elles valent quelque chose pour les autres.
*****
Quand j’étais petite, le 24 décembre, mes parents nous envoyaient dormir dans leur lit, mon frère et moi, au début de la soirée. Entre les draps solides et un peu rêches dont ma mère avait hérité de sa mère avant elle, nous attendions impatiemment d’être réveillé.e.s, quelques heures plus tard, pour aller réveillonner chez mes grands-parents. On prenait la route, sachant qu’on ne repasserait sur le pont Pierre-Laporte qu’au petit matin. Ces heures de fête pendant la nuit, en rupture avec la routine habituelle, me semblaient tellement particulières et précieuses. Des moments hors du temps, chapardés au sommeil et à la normalité. J’aimais ces heures rythmées par les traditions, passées avec des gens qui sont « proches » de par les liens familiaux qui nous unissent plus que par un quotidien partagé.
J’associais ces moments à la fête, à la légèreté.
Quand ma mère est décédée, j’ai appris que les drames aussi arrivent à arracher des moments au cours habituel du temps. J’avais 13 ans. J’ai raté une semaine d’école. Ça me semblait énorme. Sûrement un peu parce que la jeune fille studieuse que j’étais s’inquiétait de manquer du contenu scolaire, de prendre du retard, mais aussi parce que cette semaine avait été libérée de tout ce qui régit normalement le passage des heures. Chaque instant affranchi de contrainte était étonnant. J’y prêtais attention avec l’œil surpris et aiguisé de la voyageuse qui découvre un paysage inconnu, en remarquant le relief dans ses moindres détails.
Cinq ans plus tard, j’ai renoué avec ces moments étranges. La famille de mon père s’était rassemblée autour de lui, encerclant son lit pour lui dire au revoir alors qu’il mourait du cancer.
Je venais d’avoir 18 ans. C’était la Saint-Jean. De la chambre, à cinq minutes à pied des Plaines, on entendait des échos de party, de feux d’artifice et d’herbe mouillée par la bière. J’étais allongée près de mon père, dans un monde parallèle. Cette nuit-là, je n’ai pas passé des heures à chercher mes ami.e.s d’un point de rendez-vous à l’autre. Cette nuit-là, j’ai appris la longueur du temps qui passe entre deux respirations, laborieuses, quand on a peur que chacune d’entre elles soit la dernière.
*****
J’ai vécu beaucoup de deuils. Je ne sais pas si c’est possible pour moi de réfléchir à leurs impacts sur ma perception du temps sans basculer dans un texte mélodramatique. Déjà, en quelques paragraphes, mes deux parents sont morts. Je sais que c’est intense. Ça l’a été. Ça l’est encore d’ailleurs.
Je ne peux pas faire comme si ça ne m’était pas arrivé. Comme si ça n’avait pas modelé la personne que je suis aujourd’hui. Comme si je n’avais pas vécu, quelques années plus tard, une autre mort qui m’a broyée.
*****
Le 1er février 2014, Paul, mon bébé de quatre semaines est décédé après trois jours passés aux soins intensifs, dans un état critique. Pendant ces journées d’angoisse et celles qui ont suivi la mort de Paul, dans ces moments auxquels rien n’aurait pu me préparer, j’ai reconnu avec un mélange de soulagement et de désolation ce réflexe, chez les gens autour de moi, autour de nous, de ralentir leur allure en notre présence.
Face à la vie de Paul, arrachée. Face à la mienne et à celle de mon amoureux, en suspens dans le no man’s land du deuil pas entamé. Face à notre désespoir, nos proches ont calqué leur rythme sur le nôtre, lent et confus. Pendant des jours, des semaines, ces personnes nous ont offert la douce impression que seul notre malheur existait, que leurs calendriers, soudain, étaient libres de tout empêchement.
J’ai douté que j’allais survivre à la mort de mon fils. Déconnectée du cours normal de la vie, j’errais, hébétée. J’ai fui. Puis, me rendant compte que la peine me collait au corps peu importe où j’étais, j’ai décidé de retourner travailler, pour m’occuper, pour remplir le temps désespérément libre de ce congé parental sans bébé.
D’abord, j’ai résisté à me réengager tout à fait.
Mais petit à petit, je me suis sentie absorbée, entraînée par l’élan du quotidien. J’ai recommencé à noter les rendez-vous, à accepter des invitations. Après quelques mois, je pédalais, arrivant à peine à m’accorder les moments de solitude dont j’avais désespérément besoin. Les doigts sur le clavier, j’essayais d’ordonner mes pensées bouillonnantes et confuses, pour arriver à intégrer à ma vie, à moi-même, l’immense vide qu’il me restait.
*****
Le 29 janvier dernier, la violence raciste a emporté la vie de six personnes et stoppé le cours normal de la vie de leurs proches, de leurs communautés. Vu la portée publique et historique de ce qui s’est passé, le rythme de la vie de la ville et des médias d’information en a aussi été affecté.
Dans mon petit milieu, dès les premières heures qui ont suivi la tragédie, c’était l’effervescence. Réflexe militant, on se demandait comment réagir. Quoi organiser? Où? Quand? Vite!
Ma boîte de messages surchauffait, les appels à des rassemblements, parfois contradictoires, fusaient.
Dans l’urgence d’agir, les contraintes de nos agendas se sont temporairement levées. Soudain, nous voulions être là, maintenant. Le lundi 30 janvier, des milliers de personnes étaient rassemblées pour dénoncer la haine.
À peine quelques jours plus tard, déjà, nous avions retrouvé nos réflexes et nos calendriers trop remplis, les médias étaient passés à un autre appel et la classe politique était retombée dans le confortable terrain de la partisanerie. À la marche de solidarité du 5 février, organisée par le Centre culturel islamique de Québec, à laquelle je n’ai pas été présente (j’avais un autre engagement, voyez-vous), une amie a bien résumé la situation : « C’est un luxe de pouvoir passer à autre chose. »
*****
Peu importe la violence du choc, peu importe la durée de la trêve, éventuellement, les exigences du quotidien, parfois subtiles, souvent pas du tout, recommencent à s’imposer, à structurer nos vies. Elles nous donnent cette impression de vérité absolue, comme si elles étaient immuables, comme si nous n’avions aucune prise sur la vitesse à laquelle nous acceptons de vivre nos vies.
C’est forcément d’une position privilégiée que j’affirme que je pourrais ralentir. Je ne veux pas nier que pour beaucoup de monde, les journées surchargées sont une question de survie. Mais j’ose me suggérer de prendre le temps, je me permets de nous proposer de prendre le temps, parce que la glorification de l’agenda surchargé que j’observe autour de moi est rarement une question de subsistance.
Et aussi parce que nos horaires débordants qui s’entrechoquent me désolent.
Parce que je me demande comment développer des amitiés quand on doit s’y prendre trois semaines d’avance pour le moindre souper.
Parce que je me demande si on peut bâtir des solidarités quand on est tellement dans l’jus à organiser des manifs et des rassemblements et des événements qu’on n’arrive pas à participer à ceux que d’autres tiennent à bout de bras.
Parce que des fois, la lenteur du deuil me manque.
Parce que je crois que peut-être, tout ça est lié, un peu.
