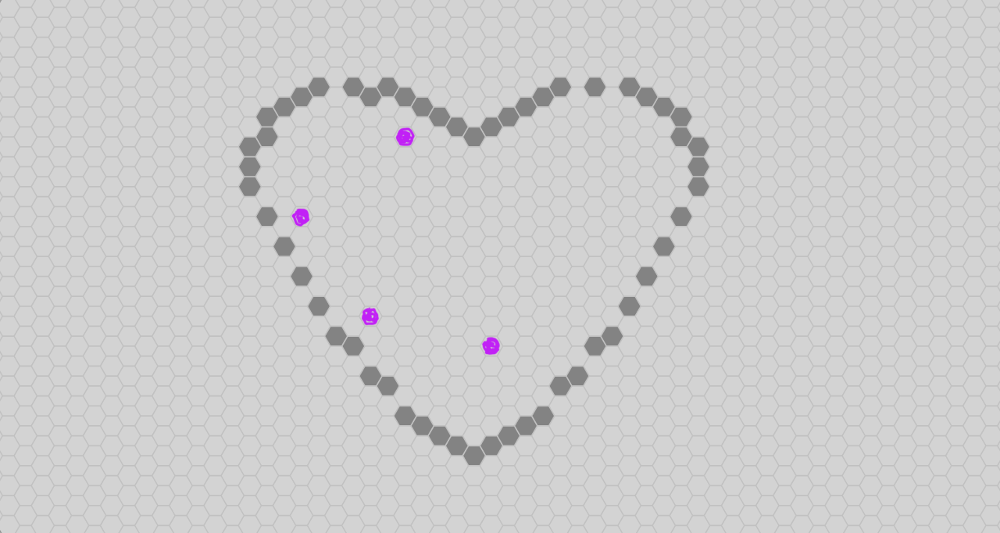Nous, vous, ils
CATHERINE LEFRANÇOIS
Pour le collectif
Une revue qui paraît trois fois par année peut difficilement coller à l’actualité. Ici, le hasard a bien fait les choses et dans les semaines qui ont précédé la parution de ce nouveau numéro ayant pour thème la communauté, trois polémiques (bon, enfin, deux polémiques et un texte qui ne semble avoir mis que moi en maudit) sont venues alimenter nos réflexions. Je vous les présente en ordre chronologique.
- Le 16 juin dernier, quatre jours après la tuerie du Pulse à Orlando, Béatrice Martin signe dans Vice un op-ed dans lequel elle exprime son désarroi par rapport à cette tragédie et fait son coming out en tant que queer. Les réactions négatives fusent sur les réseaux sociaux comme dans les médias traditionnels. On l’accuse entre autres de chercher à attirer l’attention, et les habituels arguments homophobes abondent : les « étiquettes » sont complètement dépassées et il y en a de toute façon beaucoup trop, c’est juste pour se rendre intéressant, ces gens se getthoïsent eux-mêmes, etc.
- Le 25 juin (le lendemain de la Saint-Jean, tiens donc), Mathieu Pelletier publie dans la rubrique « Le Devoir de philo » du journal Le Devoir un essai intitulé « Michel Freitag et l’après-projet de loi sur le discours haineux ». Le chapeau nous annonce que la « défense des droits particularistes peut être un instrument de dissolution de la société », rien de moins. On y apprend évidemment que nous sommes en « crise civilisationnelle » et que les droits des minorités sont une menace pour la société et les valeurs communes. Je m’étonne encore aujourd’hui du faible écho qu’a eu ce texte au sein de la communauté progressiste.
- Enfin, le 3 juillet, Alexandra Pelletier et Marie-Pier Lauzon publient chez Ricochet une lettre ouverte intitulée « Progressiste, vraiment ? » qui critique le projet de loi 103. Les auteures s’attaquent à ce qu’elles décrivent comme une vision « individuelle et apolitique » du genre qui serait nuisible à l’analyse féministe radicale « jugée assez classique jadis » et qui insistait sur les dimensions construites et politiques de celui-ci. Florence Paré a publié une brillante réplique quelques jours plus tard.
Il y a un point commun entre ces trois conversations, soit celles à propos des identités sexuelles, des libertés religieuses et des enjeux touchant les personnes trans : une partie de ceux qui se disent de gauche et progressistes mettent souvent en garde contre les revendications de ces « minorités », qui affaibliraient supposément le droit de la « collectivité » d’imposer une éthique et une morale valables pour tous et toutes. Très conscients qu’il s’agit d’une position qui est traditionnellement associée à la droite et qui est loin d’être largement partagée dans leur propre famille politique, les tenants de cette posture ont souvent recours, dans leur rhétorique, à l’épouvantail du néo-libéralisme : ces revendications « particularistes » porteraient sur des droits individuels, et s’inscriraient donc dans une exacerbation de l’individualisme liée au néo-libéralisme. Voyez la pirouette sémantique : liberté/libéralisme, individuel/individualisme. Ces termes recouvrent cependant des réalités multiformes et le libéralisme, néo ou pas, n’a pas le monopole des réflexions sur la liberté et sur l’individu. Le glissement droits individuels/individualisme joue une fonction rhétorique bien particulière : celle de sous-entendre, sans le dire, que de réclamer ces droits serait un caprice fondé sur l’intérêt personnel, et que cela nuirait aux « vraies » causes dont les victoires pourraient assurer des bénéfices à tout le monde. Ce discours n’a rien de neuf et certaines de nos lectrices se souviendront peut-être de la difficile position des féministes marxistes des années 1970, qu’on accusait de diluer la lutte avec leurs affaires de femmes.
Mais qui compose donc cette collectivité qu’on semble vouloir défendre à tout prix ? S’il faut la défendre contre les revendications des « minorités », ces dernières peuvent-elles aussi en faire partie ? La « société » excluerait-elle donc les gais, les queers, les néo-Québécois, les personnes trans ? Les termes employés dans ces argumentaires sont révélateurs. « Collectivité » et « société » sont pour le moins rassembleurs : le lecteur, la lectrice s’y sentira forcément inclusE, et s’identifiera donc à l’auteurE du texte. Ces concepts sont fondés sur des caractéristiques qui nous sont tous communes. Nous sommes nous, hourra ! Les minorités veulent des choses, boooouuuh les minorités ! Elles « nous » menacent !
Commençons maintenant la ronde des évidences. Une collectivité est bien entendu composée d’individus. Par exemple, « les Québécois » fait référence à un groupe d’individus qui sont citoyens du Québec. Quiconque doté de bonne foi sera prêt à reconnaître que toute collectivité d’une certaine importance numérique est également composée d’une multitude de communautés regroupant une partie de ces individus sur la base de caractéristiques communes à eux seuls : les femmes, les amateurs de ringuette, les habitants de Limoilou, les lecteurs de Marie Laberge, etc. Ces différentes communautés sont elles-mêmes plus ou moins importantes numériquement parlant, dotées d’une identité collective plus ou moins forte, sont plus ou moins organisées. Tiens, une autre évidence : chaque individu appartient à plusieurs communautés et son quotidien s’articule autour de plusieurs identités ou de plusieurs appartenances, certaines choisies, d’autres non, et dont certaines peuvent même entrer en contradiction. Quelle découverte ! Ainsi, pour ma part, je suis citoyenne du Québec, blanche, femme, mère, résidente du quartier Saint-Pascal, musicienne, membre de la famille Lefrançois (et Royer, et Beaudet, etc.), employée de l’Université Laval, abonnée de la bibliothèque de la Ville de Québec et du Devoir, féministe, fan de country, auteure et éditrice à temps perdu, adepte de séries télé, buveuse de Cheval blanc, et j’en passe. J’ai choisi d’appartenir à certains de ces groupes ; à d’autres, non. Dans certaines de ces communautés, je connais presque tout le monde ; dans d’autres, je suis une anonyme parmi des anonymes. J’ai envers certaines de ces communautés un sentiment d’appartenance très fort, qui détermine fortement mon identité ; c’est cependant de moins en moins le cas en ce qui concerne mon abonnement au Devoir, just saying. Dans certaines de ces communautés, je m’attends à pouvoir évoluer en accord total avec mes valeurs (dans le milieu féministe, par exemple), au point où une atteinte à cette condition remettrait en question mon adhésion (sérieusement, Le Devoir, je suis vraiment à la veille de me désabonner). Ailleurs, je choisis de prioriser mes relations avec les autres : par exemple, je veux connaître mes voisins, les parents des enfants qui fréquentent l’école de ma fille, encourager les commerces de mon quartier, et je ne m’attends pas à ce que tous ces gens partagent mes idées politiques. Par ailleurs, certaines de ces appartenances exercent plus de contraintes que d’autres dans ma vie quotidienne, le mot contrainte étant ici entendu au sens le plus large (déterminants économiques, géographiques, sociaux etc.) Bref, mon appartenance à ces diverses communautés n’est ni de même nature ni d’importance égale selon l’angle sous lequel on les envisage, voire d’un moment à l’autre de la journée. Enfin, je retire de certaines de ces appartenances des privilèges immenses. Je suis blanche, « de souche », hétérosexuelle, je vis avec le père de mes enfants qui partage aussi ces trois caractéristiques. Jamais on ne me demande d’où je viens, d’où viennent mes enfants, qui nous ressemblent à tous les deux. Partout où je vais je suis « chez moi », j’ai des papiers d’identité à mon nom, avec le bon sexe, et je peux frencher mon chum en public autant que je veux. En tant que femme et féministe cependant, je suis consciente des inégalités de sexes et de genre et je me sens solidaire de tous les groupes qui oeuvrent pour l’égalité et la justice sociale. Or, dans le discours militant aussi, l’aspect collectif a une valeur positive très forte ; on se regroupe, on s’épaule, on tente de faire valoir les avantages de nos revendications pour l’ensemble de la société. Quand on veut discréditer une féministe cependant, en général, on ne s’attaque pas au mouvement. Non, on lui trouve même du bon (ailleurs qu’ici s’entend, parce qu’au Québec hein, on est tous égaux et on vit même dans une société matriarcale). On traite plutôt ladite féministe de folle, de nazie, de mal baisée ou encore on lui explique gentiment pourquoi elle a tort.
C’est le même mécanisme qui est en jeu lorsqu’on tente de réduire les revendications de certaines communautés à des revendications individuelles : l’objectif est de les discréditer. Ainsi, leurs demandes ne concerneraient pas tout le monde. Ah non ? Pourtant, à ce que je sache, les personnes trans, par exemple, exigent des choses qui vont de soi pour la majorité, soit le droit d’évoluer dans l’espace public en toute sécurité, le droit d’avoir en sa possession des documents gouvernementaux portant l’identification de genre correcte, le droit de choisir ou de changer son nom. Tiens, c’est drôle, je possède déjà tous ces droits sans jamais avoir eu à les demander.
On tente aussi de discréditer certains mouvements collectifs en leur reprochant d’essayer d’obtenir des droits par le biais des tribunaux, comme si le fait que le progrès social passe d’abord par la branche judiciaire plutôt que législative lui enlevait de la noblesse. Oui, j’ai souvent lu ça. Et oui, dans certains cas, des avancées se font devant les tribunaux, dans des causes qui opposent une personne à une autre ou à une entité (gouvernement, entreprise, etc.). Et si vous pensez que le droit civil ne sert qu’à régler des chicanes entre voisins, tapez donc « Jean-Guy Tremblay contre Chantal Daigle » dans Google. Si on avait toujours attendu que les dominants accordent aux dominés tous les droits dont ils jouissent eux-mêmes, on ne serait pas rendus très loin. Et pensons aussi un instant aux grands mouvements structurants des deux derniers siècles : le féminisme, le mouvement des droits civiques, la lutte homosexuelle, par exemple, des mouvements larges dont les revendications ont été faites au nom de millions de personnes. De plus, celles-ci ont porté sur des droits pourtant considérés comme fondamentaux et faisant partie de ce qu’on nomme encore parfois les « droits de l’homme » : droit de vote, sécurité, liberté, autonomie économique, etc. Ces revendications ont aussi été dépeintes comme des caprices et comme des menaces à la stabilité de la société en leur temps.
Je ne sais plus qui a dit qu’une communauté se définit en posant des limites, donc en excluant. Que les fans des Beatles et les fans des Rolling Stones se regardent de travers est plutôt bénin. Que mon quartier ait des limites géographiques définies (quoi que j’en connaisse certains qui débattent encore des limites de Limoilou) et exclut donc certains de mes amis ou encore sépare une rue en deux, ce n’est pas bien grave non plus. Oui, toute communauté idéologique est confrontée à des questions brûlantes (la communauté féministe n’y échappe pas) et toute collectivité est agitée par des dissensions et des débats. Argumenter et faire valoir ses idées est important et ce droit devrait être accordé à chacun. Mais quand les dominants s’arrogent le droit de définir les contours de la société et celui d’en déterminer le meilleur intérêt, ils nuisent au tissu même de la communauté qu’ils tentent de défendre. Opposer « minorité » et « collectivité », c’est pratiquer l’exclusion de manière déguisée, et rendu là, aucun argument n’en vaut vraiment la peine.
Collectif éditorial
Marie-André Bergeron
Valérie Gonthier-Gignac
Catherine Lefrançois
Marie-Michèle Rheault
Djanice St-Hilaire
Julie Veillet
Graphisme: Djanice St-Hilaire
Illustrations: Catherine Lefrançois
Révision: Julie Veillet