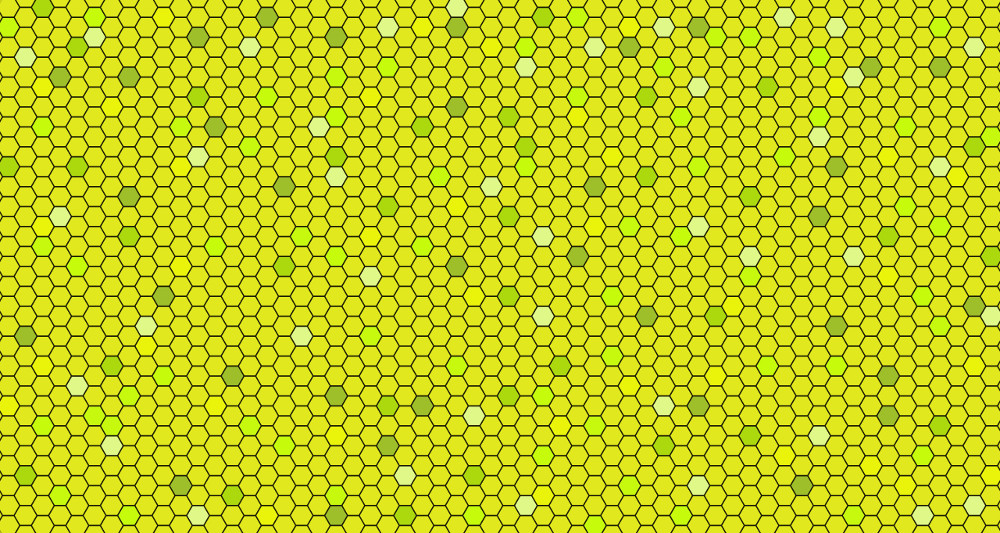Les communardes, une communauté invisible?
MARIE-PIER TARDIF
L’un des épisodes insurrectionnels ayant le plus marqué l’histoire de la France est certainement la Commune de Paris, proclamée le 18 mars 1871. Véritable expérience de la vie communautaire, la Commune se développe autour d’un imaginaire politique de la démocratie radicale qui fait la promotion des valeurs d’égalité et de liberté. Pendant soixante-douze jours, le peuple parisien se dresse contre le gouvernement versaillais pour devenir un chantier de transformation sociale où règnent les pratiques de l’autogestion et de la fédération, héritées de la tradition socialiste. Au-delà de l’expression d’une résistance collective, cette insurrection constitue un terreau fertile pour la création de groupes de femmes engagées qui frayent la voie au féminisme du XXe siècle. S’organisant hors des instances masculines, les insurgées mettent en place de nouvelles formes de sociabilité, traditionnellement réservées aux hommes, qui aspirent à améliorer le sort des femmes tout en menant la lutte populaire. Au nom de la sororité, elles s’approprient l’espace urbain pour placer la question des femmes au cœur de la réflexion commune sur la reconfiguration de l’humanité. Qu’elles soient cantinières, ambulancières, oratrices, journalistes ou instructrices, les communardes mettent en place un réseau associatif au moyen duquel elles parviennent à penser l’entrecroisement complexe des rapports sociaux de sexes et des inégalités de classes sociales. Pourtant, la participation en masse des femmes à la Commune semble négligée par l’historiographie officielle. Ce phénomène s’explique en partie par le tabou puissant dont cet événement fut l’objet durant plusieurs décennies, mais surtout par les représentations de femmes véhiculées dans la presse de l’époque qui ont masqué la dimension collective de leur expérience insurrectionnelle. En effet, les périodiques ont alimenté une imagerie révolutionnaire basée sur une conception binaire de la masculinité et de la féminité qui a eu pour conséquence de dénier l’existence des collectivités de femmes. Au temps de la Commune, les périodiques sont le mode de diffusion privilégié pour promouvoir des idéaux politiques, tant du côté des révolutionnaires que des conservateurs. Or ils traduisent la misogynie qui traverse la société du XIXe siècle en engendrant la production d’une culture visuelle abondante, axée sur les techniques graphiques du dessin et de la gravure de presse aptes à assurer une reproduction en série et une diffusion auprès d’un large public, où l’appréhension de l’actualité politique s’effectue au prisme d’un paradigme de genre qui procède à l’individualisation et à l’essentialisation des sujets féminins.
Iconographie communarde : une politique du genre
Bien que les images diffusées lors de la Commune se veulent avant tout le reflet d’un positionnement idéologique à l’égard du conflit social ayant cours, elles accomplissent aussi la fonction de formater le réel en lui imposant une signification éminemment genrée. L’insurrection populaire est pensée à travers un paradigme de genre qui assigne aux événements politiques des traits se fondant sur des natures soi-disant féminine et masculine. Ces représentations, qui procèdent des stéréotypes de genre basés sur la croyance en une différence naturelle des sexes, déterminent également les modalités d’interprétation par lesquelles le politique est signifié à l’aune des variables historiques de masculinité et de féminité[1]. Fait notable, les images de femmes sont essentiellement réalisées par des artistes masculins dont le privilège de genre leur permet de contrôler l’univers des représentations en se mettant au service de la reconduction des codes dominants patriarcaux. D’un côté, les contre-révolutionnaires discréditent la Commune en la dépeignant sous une forme féminine qui transgresse les conventions associées à la vision du genre selon lesquelles les femmes sont prédestinées à la maternité et aux tâches liées à l’économique domestique en raison de leur infériorité naturelle. De l’autre, les révolutionnaires opèrent une virilisation de leur lutte collective en identifiant la radicalité politique à un idéal de masculinité pour redonner une image crédible de la Commune. Cette opposition entre féminin et masculin, qui structure les représentations visuelles de la Commune, a pour effet d’occulter le rôle déterminant des femmes au sein du processus révolutionnaire. Adoptant un même lexique identitaire, les conservateurs et les révolutionnaires dénient l’expérience politique de vie associative chez les communardes au sein de l’iconographie révolutionnaire. Que leur perception des femmes soit positive ou négative importe moins que les mécanismes culturels et les dispositifs narratifs auxquels ils obéissent pour rendre invisible leur communauté, lesquels correspondent à l’individualisation et à l’essentialisation. Le premier consiste à représenter les femmes sous forme de figures allégoriques dont les visages n’existent que dans la réalité abstraite du symbole. Le second consiste à afficher les femmes en groupe, mais en multipliant les poncifs à propos de la différence biologique entre les sexes pour les exclure de l’arène politique et les cantonner à la sphère domestique.
Individualisation et allégorie
Dans un premier temps, les dessins et les gravures de presse qui circulent dans les périodiques au moment où se déroule la Commune réduisent la communauté des femmes à quelques figures allégoriques qui personnifient des convictions politiques associées à des préjugés genrés. Dans la presse versaillaise, les images servent une rhétorique réactionnaire qui s’exprime par l’intermédiaire d’une effigie féminine utilisée comme figure repoussoir pour discréditer la Commune. Ainsi, un large éventail de figures féminines est déployé pour symboliser la dimension négative de l’insurrection, qui va des Amazones jusqu’à Jeanne d’Arc[2]. Ces figures de guerrières sont puisées à même une mythologie sociale à laquelle recourent les conservateurs pour alimenter le sentiment de peur auprès de l’opinion publique. La guerrière, à l’image de la Commune, représente un danger pour la société puisqu’elle contrevient à l’ordre établi, c’est-à-dire à celui où règne le pouvoir des hommes sur les femmes et des gouvernants sur les gouvernés. Parmi les figures les plus couramment évoquées se trouve la cantinière dont l’uniforme et l’intervention militaire dans la sphère politique sont susceptibles de scandaliser l’opinion publique. La cantinière fait référence à la femme militaire qui faisait partie de l’armée française depuis l’Ancien Régime jusqu’à l’aube de la Grande Guerre. Bien que tolérée dans les rangs de l’armée, la cantinière était toutefois perçue comme une créature appartenant à un « troisième sexe[3] » dans l’imaginaire social du XIXe siècle. Ni femme ni homme, la cantinière transgresse ainsi les normes de genre en pratiquant une activité marginale vis-à-vis des impératifs féminins qui brouille les frontières sexuelles et ébranle la masculinité hégémonique militaire. Cette figure s’amplifie ensuite progressivement pour aboutir dans le mythe redoutable de la pétroleuse qui relève de la croyance selon laquelle les femmes déclenchaient systématiquement des incendies dans les rues de Paris. Pur fantasme, la figure de la pétroleuse est convoquée dans la propagande versaillaise pour marquer la Commune du sceau de l’illégalité. Si ces représentations entendent disqualifier la révolution parisienne aux yeux de l’opinion publique, elles y parviennent en marginalisant les comportements des femmes et en les retranchant de leur communauté d’appartenance. En effet, l’allégorie individualise les communardes en les inscrivant en faux contre la dimension collective de leur mission sociale et de leur engagement politique. Or les cantinières de 1871 s’organisent entre elles pour participer à l’action militaire en réponse à leur exclusion formelle de la Garde nationale, milice révolutionnaire entièrement composée d’hommes. En vue de faire front commun, les cantinières se regroupent autour d’une même bannière pour intervenir activement sur le champ de bataille en compagnie des ambulancières, qui se chargent de prodiguer des soins médicaux aux blessés. Cette réalité collective est pourtant escamotée par le système de représentation visuelle mis en place dans la presse bourgeoise. En privilégiant des portraits féminins individualisés, dont les attributs servent tour à tour à pourfendre l’insurrection populaire et à criminaliser les communardes, les images contre-révolutionnaires viennent atomiser la communauté de femmes insurgées qui revendiquent leur pleine appartenance à la nébuleuse révolutionnaire.
Dans l’iconographie révolutionnaire que diffusent les périodiques libertaires, la communauté des femmes semble le plus souvent ignorée, puisque les communards exaltent une vision masculine de la révolution. En effet, les révolutionnaires opèrent un processus de virilisation de la révolte armée, qui est considérée comme l’apanage des hommes. En réponse à la propension des critiques bourgeois à revêtir la Commune de caractéristiques féminines pour invalider leur prise de pouvoir collective, les révolutionnaires assignent à l’insurrection populaire des attributs masculins pour en redresser l’image auprès du peuple français. Pour insister sur la légitimité de leur lutte politique, ils véhiculent des images qui associent les valeurs de raison, de force et de courage au genre masculin. La représentation de la milice révolutionnaire à travers la mise en scène d’un modèle de la masculinité hégémonique militaire participe ainsi à la naturalisation du genre et à la reconduction des stéréotypes sexués. Réfractaires à la présence des femmes au sein des instances révolutionnaires, les communards mettent en place des instances collectives où l’intervention de celles-ci n’est pas admise. Indissociables des formes de pouvoir politique, ces espaces sont de hauts lieux de prise de décision commune. N’ayant pas droit de cité, les femmes sont ainsi écartées en masse de la sphère du pouvoir. L’intolérance des révolutionnaires à l’égard des communards témoigne de la misogynie qui a cours dans les milieux socialistes au XIXe siècle. Portée par des intellectuels comme Pierre-Joseph Proudhon, figure de proue de la pensée anarchiste, elle se manifeste avant tout dans la croyance en une triple infériorité physique, morale et intellectuelle des femmes, qui a pour effet de reconduire le despotisme en le plaçant sous le signe de la domination masculine. À la veille de la Commune, l’Association Internationale des travailleurs vote d’ailleurs en défaveur de l’accès des femmes au travail parce que le mouvement ouvrier, essentiellement constitué d’hommes, considère que leur unique rôle consiste à assurer l’entretien du foyer et le bien-être de la famille[4]. L’hostilité des révolutionnaires, qu’ils soient marxistes ou anarchistes, à l’égalité entre les sexes encourage les communardes à s’organiser en non-mixité en vue de créer des espaces dans lesquels les revendications féministes sont intégrées à la réflexion sur l’avènement d’une société libertaire. Cette brève parenthèse historique permet de rappeler le contexte socioculturel dans lequel la Commune s’inscrit. En promouvant une représentation masculine de la Commune, les révolutionnaires reconduisent donc le cliché sexiste de leur époque selon lequel les instances de pouvoir qui administrent les décisions politiques sont un terrain strictement masculin. Dans cette optique, l’effacement de la communauté des femmes que les révolutionnaires opèrent par l’entremise de l’imagerie révolutionnaire témoigne de leur tendance à se représenter l’insurrection par l’intermédiaire des stéréotypes de la masculinité, qui les cramponnent au même paradigme de genre auquel adhèrent leurs rivaux politiques. À cet égard, la gravure sur bois de Jacques Robert qui a largement circulé dans la presse est particulièrement révélatrice du processus de virilisation de la Commune mis en place par les révolutionnaires (figure I). Intitulée « Les Hommes de la Commune », cette gravure représente les visages en série des grands hommes avec un « h » qui ont marqué l’histoire de la Commune de Paris. Superposés en demi-lune, les visages d’hommes tracés avec définition semblent trôner sur le contexte historique qui apparaît dans la gravure en arrière-plan. Au-devant de la colonne de Vendôme, symbole du gouvernement versaillais renversé par les révolutionnaires le 16 mai 1871, les communards dominent le paysage sociopolitique de leur époque. En aiguisant les traits physiques des révolutionnaires, dont la couleur foncée contraste avec le décor grisâtre dépeignant des symboles politiques ennemis (la colonne de Vendôme, le Palais des Tuileries incendié le 23 mai 1871), la gravure accomplit une fonction commémorative en laissant entendre que l’épisode de la Commune s’incarne à travers ces quelques visages d’hommes ayant été fortement mêlés à ses événements majeurs. À la croisée de l’individuel et du collectif, cette représentation donne à voir d’un même coup l’individualité des personnalités convoquées qui sont dépeintes en bustes et la communauté masculinisée des révolutionnaires qui se manifeste en série. Singuliers, mais interdépendants, les visages reconnaissables des révolutionnaires sont ainsi identifiés à un signe de victoire politique. En contrepartie, les images de femmes qui circulent dans la presse révolutionnaire présentent les communardes sous forme d’allégories, qui possèdent un corps dépersonnalisé et individualisé servant davantage à signifier des idéaux politiques qu’à mettre en scène des individus réels ayant participé à la transformation de l’histoire.
Figure I
Jacques Robert, Les Hommes de la Commune, Paris, 1871 (gravure sur bois). Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis.
Bien que les femmes apparaissent rarement en tant que groupe unifié, elles se révèlent néanmoins à travers des figures qui emblématisent le combat mené par le peuple parisien. Cristallisées en allégorie, les femmes se détachent toutefois de leur communauté politique en traduisant les valeurs démocratiques attribuées à la révolution. Évoquant la liberté et la fraternité, les combattantes n’ont pour seule représentation que celle de la personnification, où elles ne deviennent que des sujets graphiques individualisés vidés d’humanité. Par exemple, la figure de Marianne, symbole de la Révolution française qui traverse le XIXe siècle, est récupérée par l’imagerie communarde de par le rêve de liberté qu’elle incarne. Emblème de la liberté et de la fraternité, la Marianne rouge réalise l’idéal d’émancipation rêvé par les communards en brisant les chaînes qui la lient au pouvoir politique. Si l’héritage de la République de 1789 ne fait pas consensus au sein de la tradition révolutionnaire, l’allégorie de Marianne est donc utilisée avec modération. Néanmoins, elle illustre avec force la tendance des révolutionnaires à dissoudre la communauté des femmes dans quelques visages significatifs qui servent à promouvoir une image positive des principes politiques situés au cœur de la Commune. La représentation visuelle des femmes dans la presse révolutionnaire répond donc au même processus d’individualisation mis en œuvre dans la presse réactionnaire qui s’effectue au profit de l’affirmation d’un discours politique. En effet, les collectivités de femmes sont fragmentées en figures singulières qui, sans la puissance du nombre, ne deviennent qu’un horizon de personnification d’un imaginaire social.
Essentialisation et collectivité
Dans un second temps, les images qui dressent un tableau de la Commune tendent à naturaliser la catégorie identitaire « femmes » et à renforcer la thèse de la différence naturelle entre les sexes. Qu’elles soient explicitement réduites à des rôles traditionnels ou implicitement décentrées du combat politique, les femmes se révèlent sous la forme d’une communauté fragilisée à laquelle on dénie une pleine capacité d’agir sur le cours de l’histoire. Lorsque les femmes sont représentées en groupe, elles incarnent une image stéréotypée de la féminité qui laisse entendre que leur appartenance au sexe féminin les prédestine collectivement à la sphère domestique. D’une part, les images diffusées dans les périodiques versaillais associent les lieux de sociabilité fréquentés par les femmes issues de la classe ouvrière à des espaces où règne la désorganisation politique. La gravure « Une séance du Club des femmes dans l’église Saint-Germain-l’Auxerois » de Frédéric Lix, parue dans Le Monde illustré le 20 mai 1871, est exemplaire de ce type de représentations (figure II). Peintre et illustrateur d’origine française, Frédéric Lix compose une scène dans laquelle les femmes participent en non-mixité à un club politique organisé dans une église de la capitale parisienne. Cette œuvre aux accents réalistes, de par le témoignage qu’elle livre sur les séances publiques auxquelles assistaient les femmes du peuple pour discuter de l’amélioration de la condition féminine au sein même du processus de transformation sociale, n’offre pourtant qu’une représentation stéréotypée de leur collectivité qui prend appui sur la vision bourgeoise du genre véhiculée à la même époque. Du haut de sa tribune, une oratrice revêtue d’habits indiquant son appartenance à la classe bourgeoise tente patiemment de ramener le calme dans la salle en élevant sa main gauche pour attirer l’attention de l’auditoire, essentiellement composée de femmes qui se rattachent à la classe laborieuse. Cette oratrice, qui rappelle la présence des femmes bourgeoises à la Commune, incarne l’idéal type de la féminité par sa bienséance et sa sobriété. À rebours des ouvrières, qui provoquent le désordre, l’oratrice adopte un comportement plus conforme à ceux que l’on exige des femmes au XIXe siècle. Dans cette perspective, la scène consolide l’écart entre les classes sociales en faisant de l’oratrice la norme de féminité à partir de laquelle on mesure la conduite morale des autres femmes, jugée inacceptable. Trônant sur l’assemblée populaire, l’oratrice est toutefois incapable de rappeler les ouvrières à l’ordre. Quand on sait que les clubs politiques de femmes et la personnalité de l’oratrice suscitaient autrefois l’indignation de l’opinion publique[5], force est de constater que le fait de représenter l’échec d’une oratrice à gérer une séance publique donne à lire le préjugé de l’époque selon lequel le destin des femmes se trouve ailleurs que dans l’arène politique. Bien qu’elle se distingue du stéréotype de la mère nourricière, elle ne possède pas suffisamment d’autorité pour présider une réunion publique. Le rôle qu’elle y joue apparaît ainsi comme une imposture au regard de sa vocation naturelle à la domesticité. L’éventail des stéréotypes convoqués pour caractériser les ouvrières répond à cette même volonté de décrédibiliser la communauté mise en scène dans la gravure pour reléguer les femmes à leurs fonctions maternelles. Tricotant, allaitant et bavardant à tort et à travers, ces femmes semblent avant tout soucieuses de s’adonner à la conversation et d’accomplir des actions qui s’associent à la maternité. Soumises à leur nature féminine, elles ne peuvent conjuguer adéquatement leur préoccupation pour l’accomplissement de leurs devoirs quotidiens et leur intérêt pour les affaires politiques, qui constitue le terrain de jeux des hommes. En représentant les ouvrières comme des mères au foyer, inaptes à participer à une assemblée à cause de leur prédisposition à l’indiscipline en milieu public, l’artiste donne à voir une communauté de femmes illégitime qui peine à adopter des comportements politiques. L’oratrice et les ouvrières, qui incarnent deux facettes de la féminité telle que conceptualisée au XIXe siècle, appartiennent toutefois à une réalité commune, qui est celle de la femme vouée au foyer. Par ailleurs, Frédéric Lix a réalisé une autre gravure du même genre, qui représente cette fois une séance publique tenue à l’église Notre-Dame-des-Champs entièrement composée d’hommes (figure III). Sans plonger dans l’analyse de cette image, il faut toutefois noter que la représentation des hommes qui assistent à cette assemblée entre en décalage avec la représentation des femmes abordée ci-haut au sens où ils semblent plus disposés à participer à des discussions politiques. En effet, les hommes y adoptent une posture plus rationaliste et modérée, ce qui suggère qu’ils ont bon gré mal gré leur place dans cette assemblée chargée d’une aura de sérieux et de respectabilité. Si cette illustration recèle néanmoins une dimension négative, son analyse demeure surtout pertinente lorsqu’on la met en dialogue avec la gravure présentant les réunions publiques de femmes puisqu’elle permet de mettre en évidence le système différentialiste qui les encadre. Contrairement aux hommes, les femmes ne peuvent se rattacher qu’à une communauté apolitique qui ne peut exister que dans l’ombre de la révolution.
Figure II
Frédéric Lix, « Une séance du Club des femmes dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois », Le Monde illustré, 20 mai 1871. Bibliothèque historique de la Ville de Paris.
Figure III
Frédéric Lix, (Titre et date inconnue), Image tirée de La Commune en images 1871, Paris, Petite collection Maspero / La Découverte, 1982.
D’autre part, les représentations qui circulent dans la presse révolutionnaire opèrent elles aussi une essentialisation du genre féminin qui entraîne la dénégation de la dimension collective du groupe des communardes. Ce phénomène s’exprime d’abord par la non-représentation des femmes sous forme de communauté au sein de l’imagerie populaire, qui a pour effet de montrer que la révolution est le bastion des hommes et que la place des femmes se situe entre les murs de l’univers domestique. Dans cet univers de représentations, les femmes se manifestent rarement en compagnie d’autres femmes, tandis que les hommes semblent la plupart du temps faire partie d’un regroupement. Entre la représentation en masse des hommes et la non-représentation des femmes sous forme de collectivité, se dresse l’illusion que la Commune est essentiellement soutenue par un réseau masculin basé sur la fraternité. Dès lors, la figure du révolutionnaire devient l’expression d’un parangon d’émancipation sociale dont les traits s’associent à un stéréotype de la masculinité. Mais lorsque les images représentent les femmes à un moment où elles interviennent en nombre dans la sphère publique, elles sont généralement massifiées dans une foule qui compte également des hommes. À cet égard, le dessin intitulé « La prise de Paris (mai 1871) : la barricade de la place Blanche défendue par des femmes » est particulièrement éloquent (figure IV). L’histoire raconte que la barricade de la place Blanche a été guettée par cent vingt femmes. Pourtant, le dessin dépeint les femmes aux côtés d’hommes, qui participent eux aussi à la défense de la barricade. Dans une ambiance fraternelle, les militaires de la milice révolutionnaire, grimpés sur des chevaux, encouragent les femmes armées à livrer combat en leur indiquant la direction vers laquelle orienter leur offensive et en leur offrant une poignée de main. Munies de chassepots, les femmes se chargent d’affronter l’ennemi avec l’aide des hommes. De plus, elles occupent la fonction de prodiguer des soins aux blessés, ce qui rappelle évidemment le rôle d’ambulancière que les communardes accomplissaient durant les affrontements. Ainsi, le dessin projette une image idyllique des relations entre hommes et femmes qui semblent coopérer dans un juste équilibre. Sous ce couvert d’égalité émerge cependant l’idée d’une dépendance des femmes à l’égard des hommes. Considérant le fait que les femmes auraient occupé à elles seules la barricade de la place Blanche, cette image, qui les montre pourtant en compagnie d’hommes, témoigne d’un travestissement de l’histoire qui vient consolider l’idéologie patriarcale. En effet, elle suggère que les militantes ne peuvent parvenir à leurs fins en s’organisant de manière autonome, c’est-à-dire sans recourir à l’intervention des hommes. La communauté de femmes qui s’y manifeste ne peut donc exister qu’en étant absorbée dans l’image d’une communauté mixte qui vient tempérer la représentation des femmes militarisées, incompatible avec la vision que les hommes se font de la féminité.
Figure IV
Barousse, « La prise de Paris (mai 1871) : la barricade de la place Blanche défendue par des femmes », Illustration tirée de Léon Shérer, Souvenirs de la Commune, Paris, Éditions Deforêt & César, 1871. Musée Carnavalet.
Le discours mémoriel : entre singularité et communauté
Une brève étude de la représentation des femmes en tant que communauté dans l’iconographie révolutionnaire rend compte de l’influence du système de genre sur l’iconographie révolutionnaire au XIXe siècle. Plus particulièrement, elle permet de mettre en évidence l’effacement de cette communauté au sein du processus révolutionnaire, qui tire son origine d’une idéologie sexiste œuvrant à la valorisation d’une masculinité hégémonique. Par le biais de l’individualisation et de l’essentialisation, les collectivités de femmes, qui ont réellement été actives lors de la Commune, se rompent sous le poids d’une conception masculine de la politique. Or cette manière de concevoir et de représenter les femmes a largement affecté leur mémoire dans l’histoire. En repérant les récits personnels d’auteures, notamment les Mémoires, il est possible de rétablir une vision plus juste de la participation des groupes de femmes à la révolution en colmatant le fossé qui persiste entre leur manque de représentation dans la sphère politique et leur présence en tant que collectivité engagée dans une lutte commune. En effet, plusieurs femmes se sont servies du genre littéraire des Mémoires pour raconter leur témoignage de la Commune en soulignant la dimension collective de leur expérience individuelle[6]. Des images aux récits personnels et des représentations collectives à l’expression de soi, il serait ainsi envisageable de revisiter le sens de cette communauté de femmes à la lumière de leur appréhension singulière des catégories identitaires de genre et de leur mise en forme d’une politique féministe de la sororité au sein de leur discours sur la révolution sociale.
[1] Gay L. Gullickson, Unruly Women of Paris. Images of the Commune, New York, Cornell University Press, 1996, p. 74.
[2] À ce propos, Gay L. Gullickson a bien analysé comment les caricatures bourgeoises s’inspirent de figures légendaires de guerrières, notamment des amazones et de Jeanne d’Arc, pour représenter la Commune sous la forme d’un événement inquiétant qui menace d’ébranler la morale publique. Voir Ibid., p. 99-109.
[3] Gil Mihaely, « L’effacement de la cantinière ou la virilisation de l’armée française au XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 30 | 2005, mis en ligne le 28 mars 2008, page consultée le 25 avril 2016. URL : https://rh19.revues.org/1008 ; DOI : 10.4000/rh19.1008.
[4] En 1866, l’Association Internationale des travailleurs tient une assemblée au Congrès de Genève au terme de laquelle une résolution est adoptée à propos de l’accès des femmes au travail. La croyance en une infériorité des femmes, qui incite les révolutionnaires à les confiner dans la sphère domestique et à les prédestiner à la vocation maternelle en leur refusant le droit au travail salarié, témoigne du climat sexiste prévalant au XIXe siècle, que ce soit au sein des milieux bourgeois ou socialistes.
[5] Il est intéressant de mentionner qu’André Léo, figure de proue de la Commune de Paris en 1871, a elle-même expérimenté l’hostilité des hommes à l’égard de la femme oratrice. Lors du discours intitulé « La guerre sociale », qu’elle a tenu en 1871 à l’occasion du Congrès de la Ligue de la paix et de la liberté à Lausanne, l’auditoire, majoritairement composé d’hommes gagnés aux idées socialistes, s’est indigné devant sa tentative de réhabilitation de la Commune au point où elle fut obligée d’interrompre son discours inachevé et de quitter subitement la salle.
[6] On peut citer par exemple La Détenue de Versailles en 1871 de Céleste Hardouin (1879), La Commune : histoire et souvenirs de Louise Michel (1898) et Souvenirs d’une morte vivante de Victorine Brocher (1909).