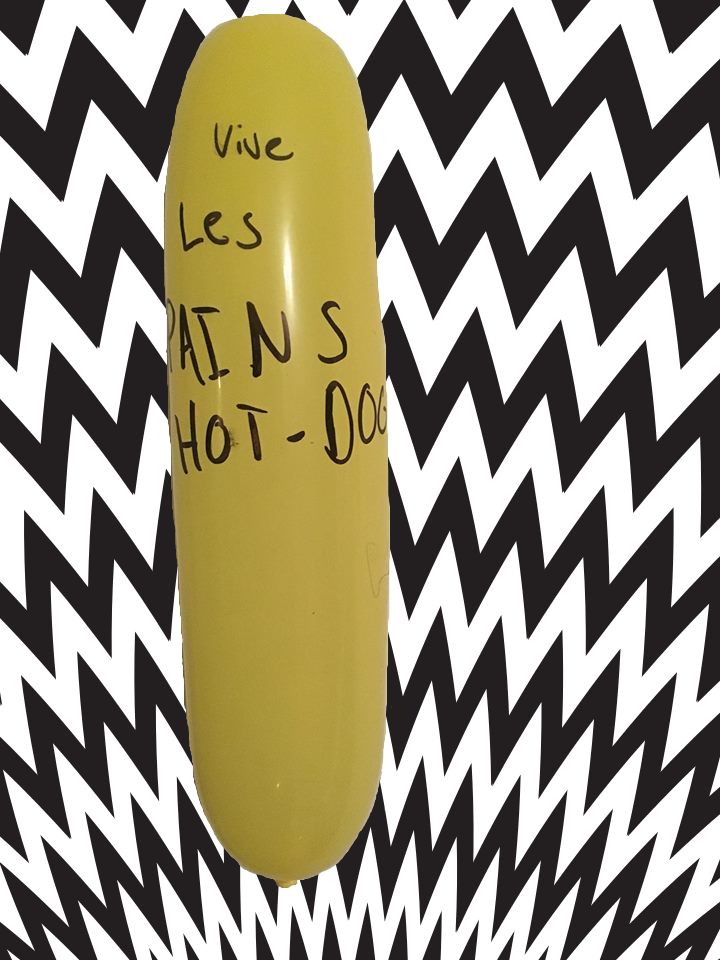La bouffe de chez nous
ZISHAD LAK
Illustration : Catherine Lefrançois
La bouffe, devenue presque une force disciplinaire pour les femmes, constitue sans doute un sujet d’intérêt pour le féminisme et pour des réflexions sur la construction de l’image féminine. On dirait que la bouffe – et le mode de sa consommation – détermine l’adhésion sociale à une citoyenneté privée, mais aussi, et surtout, à une certaine classe sociale. La surveillance institutionnelle de la collation des enfants participe à cette mesure disciplinaire qui vise dans la majorité des cas certaines classes sociales plus que d’autres. Les discours sur le végétarisme et le véganisme et les modes de consommation qu’ils mettent de l’avant s’inscrivent parfois, eux aussi, dans l’aspect disciplinaire de la bouffe et de la santé qui sont le plus souvent des soucis féminins. Ce n’est que très récemment que les hommes cis-hétéros sont soumis en masse à la pression du corps idéal et de l’alimentation « santé ». La bouffe pour les femmes est normalement (normativement) associée à une gamme d’émotions, de la fierté à la culpabilité. D’une autre part, c’est traditionnellement la mère qui est chargée de la nourriture de l’enfant et le choix de cette nourriture lui revient (la bonne mère des légumes et des fruits biologiques, la mère indigne des friandises sucrées et salées). Un sujet toutefois qui est moins abordé est le rapport entre le sujet ethnique et sa bouffe. On a commencé à parler de l’appropriation culturelle de la bouffe, des tendances alimentaires et de leurs effets destructifs sur la culture et l’économie des pays du Sud. Avec l’émergence non négligeable des écrivain.e.s et des chercheur.e.s racisé.e.s, nous nous doutons que notre quinoa, notre avocat et notre tempeh ne constituent pas toujours des choix éthiques, et nous nous demandons si notre santé l’emporte sur la subsistance des peuples du Sud mondial.
Malgré toutes ces pistes importantes, j’ai plutôt décidé de parler ici de la honte qui accompagne la bouffe ethnique et l’odeur qu’elle émet, cette odeur qui est souvent associée aux sujets ethniques et dont j’ai toujours eu horreur après avoir mangé chez ma mère. Cette honte est en même temps la cause principale de mon hésitation pour l’écriture de ce texte. Suis-je en train de me mettre au centre de mon féminisme? Cette névrose fait en sorte que j’ai décidé de ne pas nommer certaines choses, dont l’origine ethnique de la bouffe de ma mère. Je ne sais pas si c’est véritablement un choix politique, s’il provient d’une honte dont je ne suis pas encore parvenue à me débarrasser, ou bien ma tentative de garder ma position du sujet pour un public majoritairement blanc. Mais bon…
Adolescente, j’ai écouté avec étonnement les ami.e.s de ma mère rire de l’insistance de leur fille de six ans pour apporter leur bouffe ethnique à l’école. Je me suis dit que cette envie pour la bouffe de sa mère ne durera pas chez cette fillette. Quant à moi, je voulais me distancier de tout signe ethnique. J’en avais marre de me faire marquer, j’en avais marre des interrogations sur ma culture et ma bouffe. Je voulais, moi aussi, être non tachée, non marquée, faire partie de la norme; la citoyenne naturelle (et non naturalisée) qui passe inaperçue. Mais surtout, j’avais peur de devenir l’une de ces immigrantes de qui on disait qu’elles puent, qu’elles dégagent une odeur ethnique. Les immigrants puent, j’avais entendu tant de fois, et cela vient de leurs épices, de leur bouffe… ou de leurs corps pathologiques… c’est religieux… c’est culturel… c’est traditionnel… c’est spirituel… c’est l’odeur de leur sagesse exotique… mais ça pue tout de même : les spéculations abondent. Mes réflexions sur notre bouffe oscillaient donc entre une vision romantique – on porte par la bouffe la vérité du monde, notre bouffe est traditionnelle, ancestrale et donc naturelle – et un ressentiment réactionnaire par rapport à ces romantismes de la première génération d’immigrant.e.s. La bouffe de ma mère qu’enfant j’avais tant aimée, qui évoquait chez moi tout un monde, n’était plus un savoir féminin ni une manifestation d’amour. Dans ma mélancolie raciale, elle est devenue l’entêtement de ma mère à me marquer d’une citoyenneté ethnique.
Toutes ces vagues d’émotions se sont calmées avec l’âge. J’ai réussi à développer des réflexions plus claires et plus lucides à partir de ces émotions confuses. Mais la honte, on ne s’en débarrasse pas avec une dose de raison. La honte est têtue. Quand une collègue de travail à Québec m’a demandé si nous mangions la bouffe de chez nous, j’ai répondu, un peu trop enthousiaste : « Non, non, pas vraiment ». La réponse en soi n’était pas fausse. Malgré l’intérêt que mon conjoint blanc montrait envers la bouffe « de chez nous », je n’en préparais pas à l’époque et lui non plus. C’était une affaire de femmes d’une autre génération, pour moi. Mais après cette réponse trop hâtive de ma part, ma collègue a répliqué : « Ah parce que je travaillais avec une Sénégalaise et elle apportait toujours la bouffe de chez eux et ça puait. » Cette fois, j’ai eu honte d’avoir trahi cette Sénégalaise avec mon enthousiasme, voulant m’attacher à une blanchitude qui, en même temps, me vendait la bouffe d’autres ethnicités. J’ai vanté avec une fierté (osé-je dire blanche?) ma prédilection pour la bouffe indienne en prononçant sag paneer avec un faux accent anglais Indian wanna be, non comme un acte de solidarité avec les Indiennes, non pour me racheter auprès de la Sénégalaise qui aime la bouffe sénégalaise, mais comme un signe d’appartenance et d’adhésion à la blanchitude. Or, quand mon conjoint parlait de la bouffe « de chez moi » avec ses amis, je me taisais. Dans ces instants, j’avais l’impression de perdre toute possibilité d’acquérir une subjectivité blanche et non marquée et je me voyais en informante autochtone (native informant).
J’ai commencé à cuisiner la bouffe de chez nous lors de ma première grossesse et quand j’ai eu envie de la familiarité de mon aliment réconfortant, de son odeur même. Ce nouvel intérêt me lie d’une nouvelle façon à une autre génération de femmes de ma culture et ajoute une autre couche de complexité à ma relation avec elles. Je sollicite souvent les conseils de ma grand-mère, ce qui me fournit en même temps la joyeuse occasion de lui parler par Skype, car ses recettes mènent souvent à d’autres histoires qu’elle a à me raconter. Je n’aperçois pas la bouffe comme une façon de transmettre ma culture à mes enfants. Mais par le biais de la bouffe, je suis arrivée à une appréciation profonde du savoir de ma grand-mère; c’est cette appréciation que je souhaite passer à mes enfants pour qu’iels puissent grandir sans la honte qui me hante.