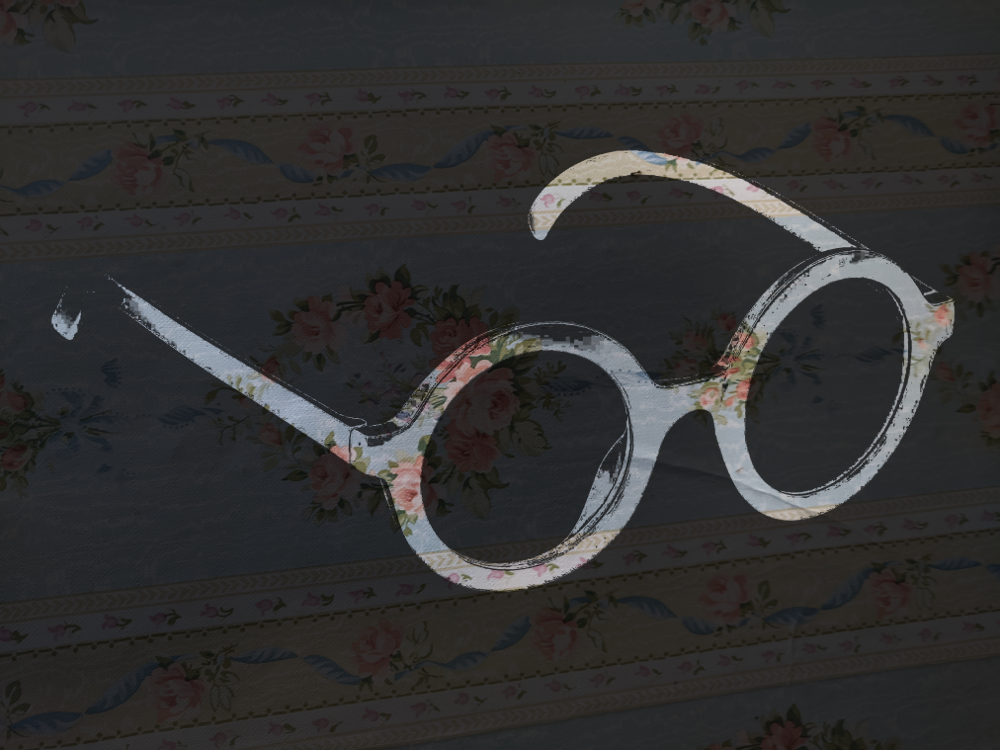Un été avec les essayistes de la Révolution tranquille. Réflexion sur la filiation et la figure de l’intellectuel.le au Québec
GABRIELLE MORIN
Illustration : Catherine Lefrançois
Mai 2019
J’aborde l’été 2019 avec un grand projet : celui de renouer avec mes affinités intellectuelles. Après les angoisses d’une session en chute libre, je suis incapable de continuer à m’identifier à cette étudiante pour qui la lecture, l’écriture et l’analyse constituaient un refuge plutôt qu’une source de remise en question perpétuelle. Pourtant, peut-être à cause des réflexes que m’a conférés le milieu universitaire, je réagis par l’affront plutôt que par le retrait, et je m’inscris à un cours d’été qui porte sur les essais de la Révolution tranquille. Au programme : Pierre Vallières, Pierre Vadeboncoeur, Fernand Dumont et Jacques Ferron, qui dans leurs œuvres dressent le portrait d’un Québec encore incertain, de cette nation parfois grisée par les possibles qui se dessinent devant elle, mais également rongée par ses défaites antérieures.
Dans le cadre de ce cours, on m’a demandé d’écrire une dissertation. Paralysée, encore une fois, j’ai plutôt écrit ce texte.
Mes lunettes sont rondes. Une monture toute fine, en métal, celle que j’imaginais il y a quelques années sur un informaticien, ou sur Jean-Paul Sartre (après une rapide recherche sur Google, vous réaliserez, comme moi, que les lunettes du philosophe ne correspondaient pas du tout à ce modèle et qu’elles étaient en fait carrées, en plastique. Nous trouverons bien un autre existentialiste à qui faire porter ma monture…) Or, si auparavant elles m’apparaissaient démodées, anachroniques, je crois maintenant reconnaître un.e complice dès que je distingue ces lunettes sur un.e jeune universitaire ou sur un ex-prof de sociologie retraité dans la soixantaine. La mode change, mes cercles sociaux aussi. Je finis un baccalauréat en études littéraires, me dirige vers la maîtrise et je porte des lunettes rondes. Apparemment, je suis une intellectuelle.
Noël dernier, lorsqu’il remarque cette nouvelle monture, mon oncle me traite successivement de « gros cerveau » et « d’artisse », puis l’emprunte et la met sur son nez, déclarant qu’il votera désormais pour Québec solidaire. La famille rit et je souris, échangeant un regard entendu avec mon autre oncle, l’oncle cool (ex-prof de sociologie retraité dans la soixantaine.) Le portrait de famille est à peu près le même chaque année – je n’ai plus la naïveté de m’en insurger, ou pire, de me complaire dans le cliché du mouton noir incompris.
Il faut dire que je m’entends plutôt bien avec ce premier oncle. S’il affirme voter pour le Parti conservateur (provincial et fédéral) et louange Donald Trump pour son franc-parler, l’opposition entre ce que nous incarnons tous les deux est si caricaturale qu’elle ne tient pas la route, du moins pas en profondeur. Nos débats politiques sont devenus un rituel, des joutes obligatoires devant le reste de la famille, qui cessent cependant dès que nous discutons en privé. Alors nos lieux communs cèdent la place aux silences confortables, et même à quelques confidences, desquelles je retiens une inquiétude maladive pour ses enfants et un sens de l’humour qui s’apparente au mien, gages d’une complicité que je peine finalement à retrouver avec l’oncle cool. Ses appartenances politiques révèlent peu de ses véritables convictions, j’en suis convaincue. Elles changent au gré du temps, en fonction des indignations les plus populaires (je sais de source fiable qu’il était fervent indépendantiste en 95, malgré ce qu’il pourrait en dire aujourd’hui), et comblent les conversations lorsqu’il n’y a plus rien à dire, plus rien qu’on ne veut dire.
« Nous donnons constamment l’impression de nous exprimer en présence de quelque témoin gênant. C’est un assez joli scandale que presque personne ici ne soit totalement vrai. [1] »
Je peux déceler la peur de s’exprimer chez plusieurs autres membres de ma famille, par exemple lorsqu’ils déversent leur fiel sur les chutes de neige à venir ou sur le troisième lien, sans jamais nommer les douleurs qui les rongent véritablement. Il me faut deviner leur intimité, dans le récit d’une maison vendue qui provoque l’insécurité, ou dans celui du nouvel amour chez une tante toujours connue seule, fenêtres entrouvertes sur des failles qu’on masque habituellement avec diligence. Or, la vérité comporte certains risques, et je vois l’écroulement qui menacerait l’équilibre familial si elle émergeait trop souvent, trop brusquement – certains excommuniés de la famille pourraient en témoigner.
Après tout, cet équilibre permet qu’ait lieu chaque année notre seule et unique rencontre du temps des fêtes, preuve de notre unicité.
J’oscille entre le désir de défendre becs et ongles ma famille contre ceux qui pourraient mépriser sa façade terne, et le désir de moi-même les secouer jusqu’à la confession. La confession de quoi, je ne sais pas trop. Tant qu’il y a confession. Cependant, je continue à parler de météo et de politique autour du buffet, je contribue au sentiment d’attente qui nous fige tous. Si je me fais critique aussi virulente des non-dits et des demi-vérités qui se multiplient parmi les miens, c’est qu’ils sont confortables pour moi aussi. Est-il plus facile d’aimer ceux qui crient? Ou plutôt, est-il possible d’aimer sans mentir – aux autres, à soi-même?
Ce diagnostic m’attriste, et m’étonne de par sa ressemblance avec celui qu’émettait Vadeboncoeur sur notre manque de véracité. Ne sommes-nous pas dans l’après-Révolution tranquille? Nous ne sommes pas « sans maîtres », sans exemples, comme l’étaient ceux qui sont arrivés à ce qui commençait, et pourtant il me semble que la mémoire nous fait défaut. À force de nous complaire des acquis, peut-être oublions-nous de contribuer à leur postérité.
« “Nous n’avons pas de maîtres”, disions-nous jeunes gens, et en effet personne ou presque avant nous n’avait été SON maître [2]. »
Je ne saurais identifier l’un de ces « maîtres » dans mon quotidien. Hypothétiquement, oncle cool serait le candidat idéal. Lui-même admiratif des penseurs de la Révolution tranquille, il dénigre cependant Catherine Dorion pour ses choix vestimentaires, et saurait peut-être nommer le nom de Gabrielle Roy si je lui demandais celui d’une autrice (mais selon lui, « auteurE » c’est plus plaisant à l’oreille). Nos filiations idéologiques s’arrêtent là où commencent celles qui m’unissent à ces femmes de lettres trop souvent omises dans les corpus scolaires. Patricia Smart. Robertine Barry. Éva Circé-Côté. Joséphine Bacon. Jeanne Lapointe. À brûle-pourpoint, ce sont les noms qui me viennent en tête, mais je sais qu’il en reste tant à apprendre ou à réapprendre. Si j’ai autant de mal à trouver ce fameux « maître », ou à incarner mon propre maître, c’est peut-être parce que je n’ai pas le réflexe de me tourner vers elles, que je n’ai pas toujours le courage de refuser l’héritage qu’on m’apprend, pour celui qui reste encore à construire.
Paul-Émile Borduas, Jacques Ferron, Gaston Miron, Pierre Vadeboncoeur. J’arrive à les admirer, sans jamais pouvoir me projeter en eux, car je doute qu’eux-mêmes aient pu me concevoir comme leur héritière. Alors que je constate l’insistance de Vallières à ériger les femmes (tout particulièrement sa mère) en ennemies du révolutionnaire, ou ce réflexe qu’ont presque tous ces écrivains de représenter les femmes seulement comme des mégères ou des amantes, Jeanne Lapointe arrive comme un soulagement, comme une grande inspiration après l’essoufflement. Lapointe a participé au bouillonnement intellectuel de la Révolution tranquille sans avoir à émuler ses collègues masculins, sans faire de compromis. Dévouée tout entière à la recherche et au mentorat de plusieurs écrivaines et étudiantes, elle n’a jamais publié de monographie, se souciant peu de son propre rayonnement dans le milieu littéraire. Lorsque je lis ses textes [3] précis, incisifs, traversés par des préoccupations féministes, je sens son regard bienveillant au-dessus de mon épaule, et je me permets de croire en la validité de ce que j’écris.
« L’écriture, jour après jour, me révélait à moi-même et me faisait exister. Je sortais péniblement de l’anonymat collectif [4]. »
Je crois avoir réussi à jouer le rôle de l’intellectuelle. Dans mes paroles, dans mon look, dans mes fréquentations, à l’aide de ces codes qui dans certains milieux vont de soi, qui dans d’autres affichent la différence (ou plutôt le souhait de l’être.) Au final, ça ne m’a servi qu’à accentuer ce syndrome de l’imposteur qui m’obsède tant. Je sais maintenant plus que jamais que j’ai envie d’écrire, alors que je n’ai jamais accordé si peu de valeur, de capital symbolique au qualificatif « d’intellectuelle ». Si j’arrive à dissocier l’acte d’écrire de cette coquille vide que peut devenir l’étiquette, et qui à certains moments immobilise mon crayon, je crois alors en la valeur qu’accorde Pierre Vadeboncoeur à l’intuition [5] dans La ligne du risque.
Mais l’intuition n’est pas une constante, elle frappe comme l’éclair, scie le doute sans le faire disparaître. C’est sur mon quotidien que le sentiment d’illégitimité règne, dans ces moments qui n’appartiennent ni à l’impulsion créatrice ni à l’angoisse viscérale, plutôt à cet entre-deux routinier qu’il me faut habiter sans toujours savoir comment. Il est alors facile d’ériger les membres de ma famille, mes ami.e.s, en ennemi.e.s de la « révolution intérieure » (pour reprendre l’expression de Vadeboncoeur) que je souhaite accomplir, de faire comme si je n’étais pas mon plus grand obstacle. Car en vouloir à mes proches m’éloigne encore plus de la chambre à soi, ce qui fait que je m’y retrouve hantée par le spectre de la solitude, plutôt qu’apte à la réflexion.
Je n’ai jamais mieux compris que maintenant la colère de Simone de Beauvoir lorsqu’elle dit vouloir tout, sans jamais vraiment y parvenir [6].
Je ne doute pas de l’écriture ou de la lecture. Je doute de tout le reste.
Je pense au film Les enfants de Refus global de Manon Barbeau, qui met en scène les enfants de Borduas, Riopelle et autres signataires de Refus global, laissés derrière eux avec les mœurs catholiques canadiennes-françaises, afin d’aller jusqu’au bout de cette « route secrète inscrite en eux-mêmes [7] ». À la suite de mon visionnement, j’associe le mot « trahison » aux automatistes, et ce, malgré sa rudesse, ses implications. Il fallait trahir les autres, ou se trahir soi-même. Dans une scène particulièrement déchirante, la réalisatrice discute avec son père, Marcel Barbeau, des raisons qui ont mené le peintre à abandonner son fils François, qui fut interné pendant vingt ans à la suite d’épisodes de schizophrénie. Lorsque, des larmes dans la voix, elle lui signifie la grande souffrance de François, Barbeau la rabroue et lui rappelle que la rupture était nécessaire :
« – Quand on a des dons, il faut les faire s’épanouir (…) Là, tu ramènes tout à toi et à tes problèmes d’enfant.
- Moi, ça me fait surtout de la peine pour François.
- (silence) Tu voudrais que moi je gâche ma vie pour lui?
- J’aurais aimé ça qu’on en prenne assez soin pour que sa vie soit pas gâchée.
- Ben oui mais… (silence) Qu’est-ce qu’on peut faire dans ce temps-là?
- Ben… (silence) Je pense qu’on peut faire ce qu’on attend qu’un père ou une mère fassent pour leur enfant.
- Tu reviens toujours au père classique. Moi, je vois pas ça comme ça.
Mon père cache une grande blessure[8]. »
Il a raison, en partie. Elle aussi. C’est un peu ça, le problème. Les vérités importent toutes, et celles qu’on laisse derrière soi créent nécessairement des souffrances. La rupture est facile lorsqu’il s’agit de rompre avec des mythes, des idées, des institutions. Lorsque les idées sont incarnées par des gamins, ça rend la chose moins noble. Il fallait être coupable. Je n’ai pas la prétention d’affirmer que je suis confrontée au même dilemme que Marcel Barbeau et ses comparses. Toutefois, je ne peux m’empêcher de penser à Suzanne Meloche (poète et femme de Barbeau), qui ne pouvait pas se réfugier dans un atelier comme a pu le faire son mari et ignorer tout bonnement son rôle de « mère classique ». Elle devait fuir, être oubliée.
« Nous étions tous obsédés par le désir de partir. Partir, partir, partir. [9] »
J’envisageais ce texte comme une victoire triomphante sur mes insécurités, mais son écriture me mène ailleurs, par nécessité de vérité, la mienne. Peut-être suis-je condamnée à poursuivre une longue tradition d’ambivalence au Québec? L’unanimité ne m’a jamais été naturelle, je possède au moins cette certitude.
« L’utopie n’est pas non plus le point final [10]. »
Certaines versions de mon texte auraient pu servir d’hymne tonitruant à notre époque et à ses femmes créatrices qui peuvent tout sans jamais rien remettre en question, famille, écriture, université, don de soi, gentillesse, santé mentale. Or, nous ne sommes pas le point final à la mouvance réclamée pendant la Révolution tranquille ni l’utopie. Les nouvelles interprétations ne naissent pas des certitudes, mais plutôt des points d’orgue, des remises en question et des regards sceptiques.
J’irai jusqu’au bout de mon doute.
« À force d’être un peuple patient, tenace et silencieux, on risque de se montrer patient même devant l’ignoble. La parole libère [11]. »
Bibliographie
BARBEAU, Manon, Les enfants de Refus global, ONF, 1998, 74 minutes.
BLAIS, Marie-Claire, « Jeanne Lapointe, une femme en avance sur son temps », Recherches sociographiques, volume 47, numéro 2, mai-août 2006, p. 223-224.
LAPOINTE, Jeanne, Rebelle et volontaire, Montréal, Leméac, 2019, 253 p.
VADEBONCOEUR, Pierre, La ligne du risque, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2010, 289 p.
VALLIÈRES, Pierre, Nègres blancs d’Amérique, Montréal, Éditions TYPO, 1994, 472 p.
[1] Pierre Vadebonceur, La ligne du risque, Montréal, Bibliothèque québécoise, 2010, p. 53.
[2] Ibid., p. 40.
[3] Marie-Andrée Beaudet, Mylène Bédard et Claudia Raby ont contribué à la publication de la première anthologie des textes de Jeanne Lapointe, Rebelle et volontaire (2019) (courez vous le procurer!).
[4] Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, Montréal, Éditions TYPO, 1994, p. 230.
[5] « [L]’intuition, moyen de connaissance de l’art, peut toucher infiniment mieux les choses que le peuvent les dissertations des universitaires et les lumières des chefs de clans ». Pierre Vallières, La ligne du risque, op.cit., p. 56.
[6] « Je veux tout de la vie, être une femme et aussi un homme, avoir beaucoup d’amis, et aussi la solitude, travailler énormément, écrire de bons livres, et aussi voyager, m’amuser, être égoïste et aussi généreuse… Vous voyez, ce n’est pas facile d’avoir tout ce que je veux. Or quand je n’y parviens pas, ça me rend folle de colère. » Simone de Beauvoir dans une lettre s’adressant à Nelson Algren, 1947.
[7] Pierre Vadebonceur, La ligne du risque, op. cit., p. 40.
[8] Manon Barbeau, Les enfants de Refus global, ONF, 1998.
[9] Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, op. cit., p. 245.
[10] Ibid., p. 418.
[11] Jeanne Lapointe, Rebelle et volontaire, Montréal, Leméac, 2019, p. 12.