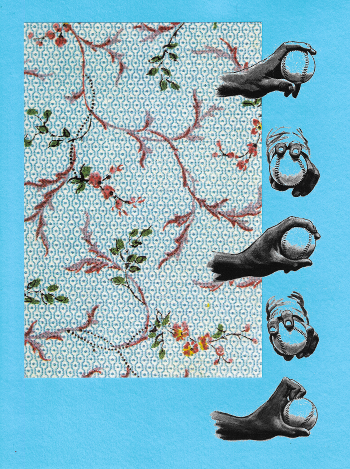Des vertus de se liguer
Durant la deuxième fin de semaine de septembre avait lieu au parc Lafontaine la finale de balle molle de La ligue en jupons, ligue établie depuis de nombreuses années. Malgré le froid et la pluie, et après avoir eu à assécher elles-mêmes le terrain en raclant la boue et transvasant de la terre autour du marbre, les filles des Canons ont affronté celles des Vénus Spéculum dans un match serré qui s’est terminé au profit de ces dernières. Un tel match entre joueuses qui pratiquent en dilettante s’est déroulé devant une foule enthousiaste et plus imposante que certaines joutes des Expos de Montréal en mai 2003 un mardi soir, quand Bouscotte jouait à la télé. Les amis, les proches et les curieux étaient nombreux (et festifs, bières à la main) pour voir à l’œuvre ces filles, issues souvent du milieu de la télévision, venues s’affronter sur un terrain de balle. La compétition est relevée, la compétitivité, au rendez-vous et la bonne humeur règne. Les noms d’équipe (Battin’ Beauties, Boules à Mites, Cherry Killers s’ajoutant aux deux précédemment évoqués) n’ont peur ni de la sexualité ni de l’ironie. Jouer à la balle molle en 2014, ce n’est pas avoir la langue dans sa poche. C’est aussi s’affilier à des femmes qui ont été des pionnières, dans la mesure où le nom de la ligue est une reprise, moqueuse et déférente, du titre français d’un « classique TVA », Une ligue en jupons (A League of Their Own).
* * *
En 1943, le baseball majeur a peur pour sa saison en raison de l’entrée des États-Unis dans le conflit mondial. L’enrôlement des joueurs dans les troupes, la baisse du niveau de jeu en raison de remplaçants peu qualifiés, les tergiversations quant à une possible saison annulée font craindre aux propriétaires d’importantes pertes de revenus. Sous l’impulsion du propriétaire des Cubs de Chicago et grand vendeur de gomme balloune devant l’éternel, une ligue de baseball féminine, la All-American Girls Professonial Baseball League (AAGPBL) est créée pour parer à toute éventualité. Bien que des femmes jouent au baseball depuis le XIXe siècle, que des équipes féminines, notamment les Bloomer Girls, aient tourné partout en Amérique du Nord à partir des années 1890 pour affronter des équipes masculines, la création de cette ligue est une première : des femmes sont engagées comme professionnelles, avec un salaire honorable pour l’époque. La ligue est pensée et dirigée par des hommes, à leur profit, et le rôle dévolu à ces joueuses est déterminé en conséquence : elles ont beau jouer comme des hommes, elles doivent apparaître comme des femmes, comme ne cessent de le répéter aux joueuses les organisateurs. Cours de maintien, atelier de maquillage, obligation de porter du rouge à lèvres, uniformes seyants (et surtout peu approprié pour le baseball) visent à exacerber la féminité des joueuses. D’ailleurs, la beauté physique faisait partie des critères de sélection. Dans l’organisation de la ligue, les femmes n’avaient aucune agentivité, ce qui fait en sorte que des chaperons les surveillaient dès le match terminé : interdiction de fumer et de boire en public, couvre-feu, etc., étaient de mise. Liberté très restreinte hors du terrain; l’avant-scène, la gloire et un véritable espace d’affirmation sur le terrain. Comme le montre le documentaire Baseball Girls, réalisé par Lois Siegel en 1995, la ligue parvient quand même à créer un espace pour ces femmes :
Women’s place is
At home
At First Base
At Second Base
At Shortstop
At Third Base
In the Outfield
At Pitching
At Catching
La ligue va durer 10 ans même si elle s’enracine dans des cités du Midwest américain assez éloignées des grands centres. Le record d’assistance (900 000 spectateurs), établi en 1948, prouve l’intérêt pour cette ligue. La qualité du jeu présentée va aussi mener certains clubs des Negro League à engager des femmes dans leur formation. Cette histoire-là, une histoire de femmes sportives, vives, athlétiques, qui gagnaient leur vie par la compétition et leur corps sans le vendre, cette histoire-là a été oubliée pendant 38 ans. Ces histoires-là ont souvent tendance à être oubliées…
* * *
Hollywood arrive alors à la rescousse et à sa manière en 1992, avec un film grand public ouvertement féministe (mais délibérément consensuel), visant à célébrer ce pan féminin de l’histoire du « national pastime ». Relecture du passé, discours contre les films reaganiens du baseball des années 1980 (Field of Dreams, The Natural), A League of Their Own (réalisé par Penny Marshall), dont le titre joue avec la thèse célèbre de Virginia Woolf et l’applique au baseball, est une réhabilitation d’un espace de liberté (relative) des femmes, tout en étant un film qui ne remet pas en cause les dichotomies de genre. L’essentiel de la trame féministe du film tient à la monstration des rapports de domination qui existaient à l’époque du film, sans qu’un élément de continuité soit évoqué pour rendre contemporaines les luttes dépeintes subtilement dans le film.
Le film, même s’il mise sur la dynamique houleuse et conviviale entre deux sœurs compétitives, est surtout centré sur la trajectoire d’une équipe, les Peaches de Rockford, des débuts pénibles jusqu’à la finale. Cette manière de filmer le sport est canonique, puisqu’elle offre la possibilité de traiter l’équipe comme un microcosme social et d’insister sur les interactions entre les athlètes, tout en misant sur le discours de l’unité et de l’effort. A League of Their Own n’y échappe pas. Tracer la composition de l’équipe, éclairer les singularités de chacune, montrer les échanges entre joueuses, c’est surtout dépeindre une sororité rieuse, quelquefois outrée, mais toujours agissante, capable de s’élever selon les circonstances.
Ainsi, c’est souvent en réaction à l’adversité qu’émerge une certaine solidarité des coéquipières. Par exemple, l’une des joueuses est très laide, bien qu’elle soit une cogneuse hors pair, qui brise tout sur son passage. Le physique jugé repoussant de Marla fait en sorte que le recruteur ne veut pas la prendre pour le camp d’entraînement. La scène est montée (prise de vue lointaine qui cache le physique de la joueuse; balle qui fracasse les fenêtres, groupe de jeunes hommes las des prouesses usuelles de la cogneuse) de telle manière que l’injustice proférée envers Marla soit palpable. Pourtant, son père intervient pour supplier le recruteur en des termes qui renversent la responsabilité du refus : « J’ai élevé ma fille comme si c’était un gars. Je ne veux pas qu’elle souffre parce que je ne l’ai pas bien éduquée. » Un tel plaidoyer, qui rétablit les rôles genrés et correspond aux normes patriarcales, n’est pas pour faire bouger le recruteur. C’est la sororité féminine instantanément développée contre l’injustice qui va avoir raison de l’homme de baseball, quand deux joueuses (et sœurs) déjà repêchées décident de faire un sit-in tant que la bonne frappeuse n’aura pas été prise.
Une telle sororité est mise constamment de l’avant dans le film. Contre le discours publicitaire qui assimile les athlètes à des reines du losange éprises de beauté, de normalité domestique, qui tricoteraient durant les matchs pour leurs enfants et maris, les filles de Peaches de Rockford lancent des jurons, boivent, fument, empoisonnent le chaperon pour sortir dans les bars, pour danser lascivement et pour s’enivrer. Surtout, elles créent leur propre espace de plaisir en vivant entre femmes. Les scènes d’autobus sont nombreuses, mimant les longs voyages de ville en ville. Toujours amenées par un plan large extérieur filmé de nuit (pour évoquer autant le dynamisme des femmes on the road que le cocon où celles-ci se trouvent), elles sont surtout l’occasion de montrer les affinités entre ces femmes, qui dialoguent à propos de problèmes privés, domestiques, amoureux ou à propos d’aspirations sociales et individuelles. S’y révèlent une entraide évidente et un désir d’autonomie, comme lorsque Doris décide de quitter un fiancé violent et méchant ou que Mea apprend à une joueuse analphabète à lire grâce à des romans érotiques.
Pourtant, c’est un homme qui dirige l’équipe; il s’agit d’un ancien joueur, Jimmy Dungan, ivrogne et désabusé, qui est là pour attirer des foules habituées aux héros masculins. Jimmy incarne le macho, celui qui considère que « les filles, c’est fait pour coucher avec, pas pour les coacher ». Son comportement alcoolique le rend inapte à diriger l’équipe, tandis qu’il dort dans l’abri. Le vide est alors comblé par la receveuse, Dootie (jouée par Geena Davis), qui agit comme leader de l’équipe, allant même jusqu’à contester l’autorité de Jimmy. Ce geste de défiance ne mène pas à un renversement de l’autorité des hommes vers les femmes; c’est plutôt Jimmy qui est transformé par ce geste et qui prend enfin ses responsabilités.
Le film est construit autour d’un immense flash-back. Dottie est maintenant grand-mère et elle hésite à se rendre à une réunion des membres de l’AAGPBL. Elle décide d’y aller et au contact des anciennes coéquipières, elle revit la première année de la ligue. Les retrouvailles se tiennent à Cooperstown, lieu du Temple de la renommée du baseball. Dans le discours national du baseball, ce musée et ce village sont les bastions à la fois de la mythologie du jeu et de son histoire, là où les prouesses sont archivées, exposées, transmises. Les pères y amènent leurs fils, pour leur transmettre un régime de valeurs, autour d’un héroïsme masculin partagé. Or, il se trouve que le passage par Cooperstown est motivé dans le film par le fait que les femmes pionnières de l’AAGPBL sont célébrées au Temple de la renommée, alors qu’une aile du musée vise à revaloriser leurs exploits. Le film se termine donc par une reconnaissance officielle, par l’exhaussement d’une histoire féminine du baseball, dont la ligue est un immense jalon. La scène, festive à souhait, couronne le film sous le double angle de la reconnaissance et du rassemblement. La sororité est réinvestie, reconstruite autour d’un match de vétéranes, dans les rires, la lumière, la chaleur des corps et des gestes. Aussi, un discours fixe, qui définit cette ligue, prend place, s’organise. Discours qui est celui du passé, non des luttes qu’il peut susciter pour le présent. La réécriture du passé mise en scène dans ce film n’endosse aucune contemporanéité, encore moins d’avenir. Ce qu’il manque, c’est le legs.
* * *
J’ai un fils de sept ans fou du baseball, phénomène probable avec un père ayant écrit une thèse de doctorat sur ce sport; il en apprécie surtout l’effet d’équipe, la discussion, le ballet particulier. Chaque soir avant de se coucher, je dois lui raconter une histoire sportive avérée (pas question d’inventer) depuis que je lui ai parlé de Jackie Robinson. Il a vu Une ligue en jupons, a beaucoup aimé et était là, encore ravi, quand j’ai revu le film pour ce texte. Entre les deux visionnements, quelque chose s’est produit; nous sommes allés à Cooperstown, reproduire, avec un certain recul certes, mais n’empêche, la geste filiale du baseball. La visite du musée est une plongée dans les souvenirs associés au jeu et un cours d’histoire, ce qu’un garçon de sept ans expérimente à son échelle. Au milieu de la visite, fiston a découvert une salle, celle consacrée aux joueuses des années 1940 et 1950, où le film de Marshall sert de truchement entre le vrai et le fictif, entre l’histoire et l’amateur cinéphile. Son regard s’est illuminé; cette histoire-là avait un sens pour lui. Il cherchait la receveuse alerte et spectaculaire qui tenait tête à son gérant; il voulait voir des photos de la lanceuse minuscule, mais combative, vive et frondeuse. Pour lui, ces femmes étaient des héroïnes. De la matière à histoires avant de se coucher.
Dans le film, après la défaite de l’équipe (vraie hérésie dans un film hollywoodien), de jeunes filles quêtent des autographes aux vedettes de la ligue, rare moment de passation où un modèle féminin est mis de l’avant. C’est l’affiliation féminine qui est célébrée. Après la visite du musée, nous avons ouvert la télévision et un match du championnat des petites ligues avait lieu; une jeune fille de 13 ans, Mo’ne Davis, par ailleurs sur la couverture du Sports Illustrated, défiait tout le monde au monticule et fiston prenait pour elle en rêvant d’en faire autant. C’était la chose la plus naturelle du monde.
* * *
A League of Their Own veut réhabiliter un pan d’histoire oublié, et oublié parce que féminin, parce que les dichotomies de genre et les structures patriarcales des grands groupes de presse (entre autres) marginalisent la place des femmes dans les sports (autrement que comme belle partisane à montrer à l’écran dans les pauses du jeu), dans les médias, dans les productions culturelles. Il le fait en montrant les contraintes de l’époque, qui renvoient les femmes, même lorsqu’une place leur est faite, à la féminité, à un canon de séduction. Dans le film, l’autorité masculine n’est pas remise en cause ni la manière dont se construisent ces contraintes; ce ne sont que les manifestations les plus anodines de cette pression sociale qui sont traitées. La puissance du film tient surtout dans la réécriture au féminin de l’histoire du baseball. À ce compte, même si A League of Their Own est le film sur la place des femmes au baseball, il me semble que Bull Durham (1988) offre davantage. Ce film tient sur la force d’une Susan Sarandon, amatrice de baseball et de sexe, femme autonome, affranchie et en position d’autorité, capable d’articuler son propre discours sur le sport, le corps, la société et qui brouille constamment les frontières entre les assignations de genre usuellement transmises. Les filles montréalaises de la ligue en jupons sont autant les héritières de Susan Sarandon que de Geena Davis.