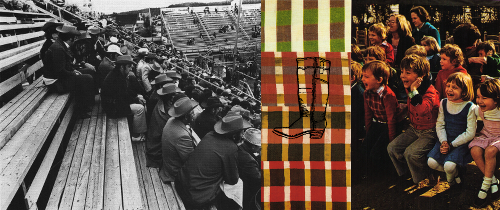Country, folklore et consommation ironique : Regarder vers le bas
CATHERINE LEFRANÇOIS
Introduction(s)
J’ai grandi dans un double univers musical. D’un côté, celui de la musique de mes parents : la chanson québécoise surtout (de Félix Leclerc à Robert Charlebois en passant par Sylvain Lelièvre, dont mon père est un grand fan), mais aussi française, et le rock des années 1960 et 1970, grâce aux impressionnantes collections de vinyles et de cassettes de mes oncles. De l’autre côté, la musique des cours de piano, aux côtés d’un professeur extraordinaire qui a tellement respecté mes préférences que j’ai réussi à traverser 12 ans d’éducation musicale sans jamais jouer une seule œuvre Chopin. Rendue à l’université, il était trop tard : j’étais une non-romantique irrécupérable, et comme me l’a dit mon prof de piano du cégep juste avant mon audition pour entrer au baccalauréat en interprétation, où on essaie normalement de jouer du répertoire exigeant sur le plan technique : « Ton Scriabine est en plywood; joue-leur donc du Mozart à la place. » En réalité, mon cœur appartient depuis longtemps à la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance; pour une pianiste, c’est assez tragique.
La place de la musique traditionnelle, à travers tout cela, a longtemps été limitée au disque de la tourtière qu’on écoutait chez ma grand-mère au jour de l’An. Pas de violoneux ni de pitonneux dans ma famille. Quand mes parents sont devenus des grands fans de la Bottine souriante, j’en suis venue à m’intéresser sérieusement au folklore québécois. Puis je suis tombée dans les musiques des traditions européennes. Puis je suis tombée dans les Pogues, puis dans le folk américain et afro-américain, puis dans le country. J’aurais pourtant dû comprendre depuis longtemps : je devais absolument apprendre d’un instrument à cordes. Je me suis acheté une mandoline.
J’ai tranquillement découvert le flot d’échanges et de métissages incroyable entre les traditions musicales d’Europe, populaires comme savantes, leurs incarnations américaines et les musiques africaines, transplantées avec l’esclavage en Amérique où elles ont donné naissance au blues, au r’n’b et au rock and roll. À un certain moment, toutes mes préférences ont enfin pris sens; j’y entendais une continuité, des résonances profondes, et ces musiques que j’envisageais auparavant séparément se trouvaient reliées par un paquet de fils, emmêlés mais pas trop.
Pardonnez-moi cet incipit biographique. J’aurais trouvé (in)délicat de parler de goût musical sans d’abord expliquer où se situe le mien et d’où il vient. Cela me permet aussi d’expliquer comment j’en suis venue à m’intéresser à la musique country au Québec et à m’y intéresser suffisamment pour en faire l’objet de ma thèse de doctorat. Car dans cette belle équation musicale, c’était la grande absente.
La musique country est née, aux États-Unis, de la commercialisation de la musique de tradition orale telle qu’elle était pratiquée dans les États du sud-est, principalement ceux que couvrent les Appalaches. C’était alors une musique métissée de musique populaire urbaine et de toutes les tendances exotiques à la mode dans les années 1920, notamment la musique hawaiienne et celle des ensembles tyroliens, et qui a emprunté énormément au blues. Elle jouit aujourd’hui d’un double statut. C’est d’une part la musique des Rednecks et des républicains. C’est d’autre part un corpus qui, dans ses manifestations les plus anciennes, s’est patrimonialisé, notamment grâce aux efforts du Smithsonian et de Folkways Records. Sa branche plus folk, moins commerciale, possède une riche tradition d’artistes contestataires, voire socialistes, communistes et anarchistes. Elle a donc le potentiel d’être appréciée par tout un chacun et elle se décline en dizaines de sous-styles dont l’improbable country rap ou hick-hop[1]. Certaines chansons des grands noms du country ou des films westerns des années 1930 et 1940 sont devenues des standards de la chanson populaire américaine qu’à peu près tout le monde connaît et peut chanter.
Au Québec, le country ne fait pas partie, ou si peu, de ce qu’on considère comme notre patrimoine musical. On dit aussi qu’il serait le genre musical qui vendrait, année après année, le plus de disques, même s’il évolue pratiquement indépendamment de l’industrie de la musique populaire. C’est un genre musical qui a définitivement peu de légitimité. Je me suis longtemps demandé pourquoi. Quelle autre pratique culturelle, au Québec, est aussi souvent un objet de dérision en même temps qu’elle est massivement appréciée? Je vais tenter de répondre à ces questions mais d’abord, permettez-moi de mélanger les choses.
Populaire, populaire
La définition la plus courante de la musique populaire est une définition négative : il s’agit de tout ce qui n’est ni de la musique savante, ni du jazz, ni de la musique traditionnelle. On y ajoute souvent une dimension médiatique : la musique populaire est diffusée par les médias de masse, par la musique en feuilles d’abord, puis par l’enregistrement sonore, par la radio, par la télévision, par Internet. C’est évidemment une définition très large, qui couvre à la fois la chanson, le rock et la pop. C’est aussi une définition qui englobe autant les marges et les sous-cultures que les machines à hits. La critique culturelle de la musique populaire se concentre d’ailleurs essentiellement sur ces deux pôles. D’un côté, des genres marginaux, perçus comme extrêmes, dérangeants, font l’objet d’une violente critique morale. C’est le cas du rock and roll, du metal et du rap qui, avant de conquérir le mainstream, ont suscité des réactions alarmistes chez la droite conservatrice. On se souvient encore du Parents Music Resource Center, puissant lobby qui imposa, dans les années 1980, l’usage des autocollants « Parental advisory » qui ont défiguré les albums de notre jeunesse et empêché leur vente dans plusieurs magasins à grande surface. Sans grande surprise, l’ire du Parents Music Resource Center frappa aussi les mégavedettes de l’époque et dans sa liste des filthy fifteen, les quinze tubes les plus immoraux, on retrouve des pièces gravées par Prince, Madonna, Def Leppard et Cindy Lauper. Et c’est ici, précisément, à propos de la culture de grande consommation, que les critiques culturels de droite et de gauche se rejoignent. Ils envisagent cette musique comme imposée à des « consommateurs » gavés de mélasse indistincte, comme une « offre culturelle » parmi laquelle le choix serait extrêmement limité, dicté par une industrie sans imagination, avide de profit, qui manipule ses artistes comme son public. Bref, la culture de masse, c’est la fin de la culture. J’exagère à peine. Comme le dit le philosophe Richard Shusterman, cette grille d’analyse constitue « une occasion tout à fait rare où conservateurs de droite et extrémistes marxistes se retrouvent main dans la main pour faire cause commune[2] ».
Avant l’avènement de médias de masse, la musique populaire était celle du peuple, la volksmusik ou la folk music des classes populaires. On se préoccupait beaucoup, dans l’Occident du 18e et du 19e siècle, de recenser, d’étudier et de préserver les folklores. On les percevait (c’est encore en partie le cas aujourd’hui) comme étant menacés de disparition par l’industrialisation et la mécanisation. Cet intérêt pour le « génie des peuples » perdure longtemps au 20e siècle et la mise en valeur des musiques traditionnelles procède à la fois de visées scientifiques, éducatives et idéologiques. La culture du peuple est souvent idéalisée à souhait par les élites, qui en recherchent une forme pure, conforme aux aspirations nationalistes et convenables (moralement) pour l’éducation populaire. Le folklore et ses interprètes ne satisfont cependant pas toujours les attentes de ceux qui le collectent. Cecil Sharp, qui a recueilli aux États-Unis des chansons des Appalaches, se plaignait dans sa correspondance de la grande propreté des maisons, même les plus isolées, des habitants chez qui il était hébergé. Leur intérieur aurait mieux convenu, d’après lui, aux « familles respectables des banlieues », lui-même préférant « la crasse et la bonne musique ». Son folklore cependant, il l’aimait bien propre. À la recherche de versions anciennes de chansons anglo-celtiques, il élimine de sa collecte les chansons de la Tin Pan Alley, le blues et les spirituals. Ce sont précisément les trois genres qui forgeront le son de la première musique country dans les années 1920, alors que le disque permettra aux musiciens amateurs issus de la tradition orale de se professionnaliser et à leur répertoire d’atteindre un auditoire national puis, bientôt, international.
Cecil Sharp et ses collègues, dans une vaste entreprise relevant à la fois de la sauvegarde et de l’éducation, ont réussi à introduire l’enseignement du folklore dans les écoles élémentaires au cours des années 1920 et 1930 en Grande-Bretagne[3]. L’équivalent, au Québec, c’est La Bonne chanson, une initiative de l’abbé Charles-Émile Gadbois : des millions de cahiers de chansons écoulés dans les écoles, des émissions quotidiennes à la radio, un folklore épuré, censuré, et surtout une bonne part de chansonnettes de bon goût, compositions originales de Gadbois et d’autres, qui sont passées dans la tradition. Après ce massacre à la tronçonneuse, nous reste de notre folklore, dans son plus petit dénominateur commun, celui qui permettrait disons à 10 personnes qui ne se connaissent pas de chanter ensemble pendant une petite soirée, nous reste, donc, principalement des chansons syllabiques, faciles à chanter en groupe, avec une métrique stable et pas trop spéciale, une harmonie tonale, sur des textes dépouillés de tout ce qui est souvent étrange, surnaturel ou violent. Si les complaintes, les mélismes et la musique modale, les histoires de mort, de trahison et de filles-mères vous intéressent, vous pouvez toujours vous présenter aux archives de folklore de l’Université Laval ou lire cet excellent texte de Michel Faubert dans Liberté.
Le folklore a souvent été le fer de lance du nationalisme et du cléricalisme et on l’a conçu comme un vecteur de bonne vertu, ici comme aux États-Unis. L’industriel Henry Ford, par qui est arrivée la mécanisation de l’industrie automobile, plaie de notre quotidien (sérieusement, fuck l’automobile), détestait par-dessus tout la vie urbaine et sa culture, c’est-à-dire le jazz, la pornographie, l’alcool et le communisme. Sa solution à ces maux de l’humanité? Le folklore bien sûr. Il était un grand commanditaire d’événements de danse traditionnelle et de concours de violon. Il fut mortifié, paraît-il, de découvrir que les bonnes gens de la campagne, en particulier les musiciens, n’étaient pas des modèles de tempérance. Au Québec, la survie du folklore a été envisagée comme étroitement liée à la survie de la langue française. Pour cette raison, et pour d’autres davantage reliées à la hiérarchie des genres musicaux, il y a un bon folklore et un mauvais folklore. Le bon folklore est en bon français et sonne vieux. Le mauvais folklore chante mal et sonne western. Il faut absolument lire l’article publié par Luc Lacourcière en 1960 dans le premier volume de Recherches sociographiques, dans lequel il retrace les origines du « Rapide blanc », chanson enregistrée par Oscar Thiffault en 1954. Oscar Thiffault est le parfait antimodèle pour les puristes du folklore. Sur des airs traditionnels, il écrit des paroles nouvelles, souvent irrévérencieuses. Il s’intéresse autant aux parcomètres qu’à Maurice Richard (qui, faut-il le rappeler, pouvait scorer de la ligne de punch) ou au Spoutnik. Accompagné par les As de la gamme et leur swing western, il propose, avec le « Rapide blanc », une version d’une vieille chanson française aussi connue sous le titre du « Moine tremblant ». Le point de départ du texte de Lacourcière est la réaction outrée de deux lecteurs du Devoir qui ont pris la peine d’écrire au journal pour dénoncer le joual de Thiffault et sa diction laxiste. « Ah! ouigne a han ». Un premier commentateur du dimanche associe la ritournelle, qui termine chacune des premières phrases d’une strophe, au hennissement d’un cheval. Une seconde lectrice veut redonner sa « dignité » à la chanson en corrigeant le chanteur, qui commettrait le « plus évident péché de bouche molle et de nez bouché » : cela se prononce « en voyageant ». Lacourcière balaie cet « amateurisme de bonne volonté » par une magistrale démonstration ethnolinguistique qui invoque une bonne dizaine de versions de la chanson et plusieurs traités de dialectes provinciaux français du 17e et du 18e siècle. Le verdict est sans appel : hogner ou ouigner se retrouvent dans plusieurs versions de la chanson et ont divers sens linguistiques attestés qui vont de grogner à grincer en passant par gémir et se lamenter.
En 1960, le folklore était entré à l’université depuis belle lurette. Lacourcière fait cependant œuvre originale en prenant comme objet d’étude un enregistrement commercial, extrêmement populaire et méprisé tout à la fois. À une époque où les études culturelles émergent et où les cultures ouvrières et urbaines commencent tout juste à intéresser les chercheurs, il faut le faire. On rencontre encore aujourd’hui une certaine résistance par rapport à la reconnaissance de la culture populaire comme matrice de productions culturelles légitimes. Gilbert David écrivait l’an dernier pour Spirale, dans un texte repris par Le Devoir, à propos des difficultés du milieu théâtral et s’en prenait à l’état de la critique et de « ses chroniqueurs pâmés devant les comédiens qui remplissent les pages d’Échos Vedettes », en lançant au passage une pointe aux chercheurs qui s’intéressent à l’histoire du divertissement et de la variété : « il se trouve même des universitaires pour défendre sans rire ce qu’ils appellent la “modernité populaire” au nom de l’égalitarisme des goûts et des couleurs. Autrement dit, la Poune et Gauvreau, même combat[4] ! » Nous allons ici supposer qu’il parle du « bon » Gauvreau, pas de celui qui écrivait des téléromans et qui aurait été davantage susceptible de se retrouver dans les pages d’Échos Vedettes.
C’était un long détour, mais un détour nécessaire pour planter le décor. Notre rapport à la musique country relève de tous ces paradigmes à la fois, dans un grand fouillis idéologique et sentimental, parce que cette musique relève autant du folklore que de la musique de grande consommation, et autant de la tradition que de la modernité.
La chanson country-western : à cheval sur deux mondes
Dans les années 1930, les films westerns hollywoodiens ont la cote. Les cow-boys chantants comme Roy Rodgers et Gene Autry sont extrêmement populaires des deux côtés de la frontière, et on peut entendre au Québec plusieurs adaptations canadiennes-françaises des chansons-thèmes des films les plus populaires, interprétées par des vedettes de la radio et du disque. En octobre et en novembre 1939, soit quelques semaines à peine après le début de la guerre, Gene Autry participe au tournage du film South of the Border, dans lequel il joue un agent fédéral en mission au Mexique devant empêcher des espions étrangers de prendre le contrôle d’une raffinerie américaine pour en faire un point de ravitaillement des sous-marins ennemis. Dans une scène culte du film, portant déjà son uniforme, il chante la chanson « Goodbye Little Darlin’ Goodbye » à Patsy, la jeune sœur de sa « leading lady », sagement couchée dans son petit lit, une chanson reprise au Québec par Lionel Parent sous le titre « Adieu ». C’est en bonne partie à cause de la popularité de ces films et de l’image positive et virile du cow-boy que les artistes du country, un genre musical né, je le rappelle, dans le sud-est, ont délaissé la persona du hillbilly, le « péquenaud des montagnes », pour adopter celle du cow-boy ou du ranger, aux connotations plus positives.
On fait souvent remonter l’histoire officielle de la musique country québécoise aux débuts de Roland « le soldat » Lebrun, qui commence à enregistrer, au début de l’année 1942, des chansons de guerre en s’accompagnant à la guitare. Auteur-compositeur-interprète, musicien amateur, militaire basé à Valcartier, il chante avec une voix nasale qui rappelle immédiatement au public les chanteurs country américains; sa persona forte (il se présente en uniforme) et sa guitare évoquent quant à elles les cow-boys chantants. Ses chansons sentimentales et de guerre connaissent un succès immense, dont l’armée s’empare dans le cadre de sa propagande. Le soldat Lebrun n’enregistrera sa première chanson à thématique western qu’en 1946, alors que, la guerre terminée, sa popularité décline au profit des autres chanteurs country qui ont fait leurs débuts à sa suite, comme Paul Brunelle, Marcel Martel et Willie Lamothe, qui ont, eux, immédiatement investi l’univers western.
Bien avant le succès phénoménal du soldat Lebrun, cependant, le country est présent au Québec, notamment à la radio. Sur les ondes de CHRC, à partir de 1931, Bill Harris, « le cow-boy solitaire », anime une émission hebdomadaire consacrée à la musique country. Il participera aussi à la fondation, la même année, des Montagnards laurentiens, un groupe de folklore qui, sur le modèle du spectacle de variétés, animera des soirées musicales hebdomadaires, aussi à CHRC, jusqu’en 1962. Les réseaux des premiers chanteurs western sont d’ailleurs intimement liés à ceux des musiciens traditionnels, avec qui ils partagent souvent la scène et qui agissent régulièrement comme musiciens accompagnateurs. C’est le cas de Laurent Joyal par exemple, guitariste, frère du célèbre violoniste Gérard « Ti-Noir » Joyal, qui accompagne Marcel Martel sur ses premiers enregistrements, ou encore de Victor Martin, violoniste lui aussi, qui joue à quelques reprises avec Willie Lamothe, ce qui lui permettra d’obtenir un premier contrat de disque chez RCA Victor. Une grande proximité entre western et folklore va perdurer.
Les premiers artistes country enregistrent au sein de compagnies de disques généralistes, Compo et RCA Victor. Les enregistrements sont d’abord minimalistes : une ou deux guitares, une voix. Dans les années 1950, on commence à intégrer la contrebasse, le violon et l’accordéon, qui occupera une place prédominante dans les enregistrements de rockawilly, ces disques de rock and roll western qui mettent en valeur des accordéonistes virtuoses comme Gordie Flemming et Jean Boucher. À la fin des années 1950 et pendant les années 1960, plusieurs compagnies de disques indépendantes consacrées au country et au folklore sont mises sur pied, et le genre s’autonomise progressivement par rapport à l’industrie de la musique populaire. Certaines compagnies, comme Amical et Bonanza, ont, dans les années 1970, un catalogue impressionnant. À cette époque, le country-western est étroitement associé à la culture ouvrière : les chanteurs revendiquent des personas de camionneurs ou de mineurs, mettent en valeur leurs origines modestes et font tout pour réduire la distance entre leur public et eux. Paradoxalement, le genre connaît au même moment le sommet de son succès dans les médias de masse : l’émission Le ranch à Willie attire chaque semaine plus de 1 400 000 téléspectateurs sur les ondes de Télé-Métropole. Suivant la mode de Nashville, le country est alors aux paillettes et aux costumes flamboyants, et les arrangements n’ont rien à envier à la chanson pop et sentimentale, avec de gros effectifs qui incluent parfois des cordes. Bien que les artistes traditionnels et country soient regroupés au sein de l’Association de musique folklorique et campagnarde du Québec, les deux genres musicaux, sur disque, présentent cependant des esthétiques bien distinctes. La crise économique de la fin de la décennie ébranle sérieusement l’industrie du disque; plusieurs indépendants ferment, le marché se concentre et les géants qui s’en sortent, au Québec, mais aussi dans le reste du Canada, délaissent le country. Dans les années 1980, le genre se tourne résolument vers l’autopromotion et l’autoproduction, une situation qui perdure.
À toutes ces époques, la chanson country a eu de féroces détracteurs. On lui reprochait, dans les années 1940, de favoriser l’américanisation de la culture canadienne-française. Après la Révolution tranquille, il semble définitivement exclu de la culture nationale : trop américain, pas assez littéraire, trop populaire. Dans une entrevue accordée à Gérald Godin pour le magazine Maclean, Willie Lamothe résumait ainsi le statut du chanteur country : « On a des voix comme des manteaux de fourrure cheap. Quand les femmes vont magasiner, elles regardent les beaux manteaux, mais elles ne les achètent pas, elles n’en ont pas les moyens. Elles achètent des manteaux cheap[5]. » Certains artistes trouvent la grâce, cependant. La musique country fait l’objet depuis quelques années d’un processus de patrimonialisation qui s’amorce tranquillement et elle intéresse de plus en plus les institutions culturelles. En témoignait entre autres l’exposition Cow-boy dans l’âme, présentée au Musée de la civilisation de Québec en 2002 et en 2003. En 2003, Frémeaux et associés faisait paraître la compilation double Country Québec : les pionniers et les origines, 1925-1955, dont les notes de livret étaient signées par l’historien Robert Thérien. En 2004, les disques XXI faisaient paraître l’intégrale des enregistrements de Lebrun chez Starr (1942-1953) avec des notes de livret également rédigées par Thérien.Ces enregistrements anciens réédités font l’objet d’un rematriçage et d’un filtrage soignés visant à éliminer un maximum de bruits indésirables. Ils sont à la fois mis en contexte comme objets historiques et offerts sous forme de produits de consommation destinés à être appréciés. Ce sont précisément les conditions identifiées par Sophie Maisonneuve dans le processus de patrimonialisation de la musique classique par l’enregistrement sonore, qui est devenue grâce à la fixation sur support à la fois « a heritage from the past and a possession that can be enjoyed[6] » auquel on redonne une valeur et une signification actuelle. Les rééditions d’enregistrements de musique populaire de la première moitié du 20e siècle s’inscrivent d’ailleurs explicitement dans la constitution et la diffusion d’un patrimoine. Le slogan de Frémeaux est « Notre mémoire collective » et l’éditeur se décrit comme « l’éditeur de référence du patrimoine musical », et Martin Duchesne, des productions XXI, confiait en 2008 qu’il avait le sentiment de participer à la sauvegarde du patrimoine[7]. Ce processus opère évidemment un filtrage; on patrimonialise certains artistes du disque seulement, et certaines esthétiques. Pour les célèbres Marcel Martel et Willie Lamothe, ce sont les enregistrements les plus anciens qui sont mis en valeur; leurs enregistrements des années 1970, qui tendent plus vers la pop et qui ont connu un succès de masse, ne font pas l’objet d’un tel traitement. Faut-il s’en étonner, la grande majorité de la production country des années 1950 à 1970, celle qui intègre le rock and roll ou les rythmes latins, du « Rock and roll dans mon lit » de Léo Benoît au disque hommage à Tino Rossi de Marcel Martel, ne se situe pas du bon côté du country. Tout comme le folklore d’Oscar Thiffaut ou de la famille Soucy d’ailleurs. Ce country-là appartient à ce que Richard Baillargeon et Christian Côté nomment, sans mépris aucun et avec beaucoup d’amour, la « musique kétaine[8] ».
Regarder vers le bas
Le country-western se balance donc entre la tradition et la musique de grande consommation. Il fait face, comme toutes les pratiques situées à un de ces deux pôles du populaire, à deux traitements bien distincts : un peu de patrimonialisation, un peu de dénigrement. Entre ces deux sanctions, il existe une position intermédiaire : l’ironie, une posture massivement appliquée au country-western.
Il est de bon ton de consommer (j’y reviens) certains des éléments de la culture country : le chapeau ou les bottes, une petite virée à Saint-Tite, une soirée de karaoké ou de danse en ligne western. Tout ça pour rire, tout ça au second degré bien entendu. C’est précisément ce que Naomi Klein a nommé la consommation ironique. Regarder Place Melrose, fréquenter les tikis-bars, ce que déjà en 1995 le zine Hermenaut décrivait comme « the independant use of mass culture products[9] ». Pour Klein, il s’agit d’une nouvelle manière de manifester son dédain pour la culture de masse, non pas en la rejetant, mais en s’y immergeant, marquant simultanément une non-adhésion aux valeurs qu’elle véhicule et l’appartenance à un groupe restreint de personnes dans le coup. « The art of being in-between, of being ironic, or camp, which Susan Sontag so brilliantly illuminated in her 1964 essay “Notes on Camp,” is based on an essential cliquiness, a club of people who get the aesthetic puns[10]. » Bref, il s’agit d’une forme de distinction.
Il est possible de critiquer cette posture sans adopter le point de vue des conservateurs sur l’ironie, qui pervertirait l’esprit des jeunes[11]. Le problème avec la consommation ironique, c’est que ce n’est pas que « pour rire ». Naomi Klein avait déjà l’intuition que cette nouvelle manière de consommer la culture n’était pas si subversive qu’on le dit et qu’elle s’inscrivait aussi dans le rejet des grands idéaux des décennies précédentes : la théorie critique et ses lectures littérales de la culture de grande consommation, la quête d’authenticité des années 1960, le féminisme des années 1970. Bref, il s’agit d’une forme de désengagement par rapport à la collectivité. Cela ne signifie pas que la consommation ironique soit dénuée de toute politique. L’analyse proposée par Annelyne Roussel à propos du sexisme hipster, et qui fait un détour par les goûts en matière de mobilier, est à cet égard éclairante :
N’est pas hipster qui veut : pour être capable d’une telle ironie face à la culture de la classe ouvrière, il faut avoir une bonne distance par rapport à celle-ci. C’est pourquoi les hipsters sont très souvent des gens issus de milieux privilégiés et instruits. En affectionnant entre guillemets certains objets aimés sincèrement par les vrais prolétaires, ils réaffirment leur position de pouvoir par rapport aux classes sociales inférieures.
Il y a donc une grande violence symbolique dans cette distanciation, dans cette appropriation d’éléments de la culture western à des fins ironiques, violence parfois à peine voilée. Voyez ici la description de la section « country » du site Radio-cochonneries de DJ Georges :
Chansons de cowboys québécois, toutes interchangeables parce que toutes bâties sur le même patron. Les mêmes rythmes, les mêmes accords, les mêmes sujets : cheval, amour de sa mère, prairies, bien-aimée, solitude. Ces chansons sont souvent réalisées avec des moyens modestes par des gens simples, alors elles sont souvent très drôles. Le DJ doit se limiter parce qu’on pourrait aisément mettre la moitié du répertoire country du Québec dans la playlist et ça deviendrait vite très lassant. Notons qu’il existe en réalité deux chansons country, sans cesse reprises avec des paroles un peu différentes: la chanson country joyeuse et la chanson country triste (également appelée « complainte »).
C’est, dit de manière crue, ce que certains chercheurs ont déjà dit ou écrit, de manière plus fleurie, à propos du country. Ah, si Luc Lacourcière était encore en vie…
Dans une entrevue accordée aux Inrocks, la géographe Anne Clerval, à propos de la disparition des quartiers populaires à Paris, faisait une observation qui s’applique tout aussi bien à la musique : « Les cultures populaires, jadis révolutionnaires et menaçantes pour l’ordre social, deviennent des objets de folklore et de consommation culturelle. » Cette manière de réifier les cultures populaires est évidemment le privilège d’une élite « capable d’absorber sa propre subversion distinguée[12] », pour reprendre les termes de Bourdieu. Cela a aussi pour effet de les rendre inoffensives, de les ramener au même plan que n’importe quel « produit » de l’« offre » culturelle, alors qu’elles sont à l’origine des musiques ancrées dans des cultures vivantes où la circulation de la musique n’est surtout pas perçue comme verticale, du haut (les artistes) vers le bas (les auditeurs), mais comme horizontale, entre les membres d’une même communauté.
En réponse aux Parents Music Resource Center sont nés les Parents for Rock and Rap. Je propose la création des Parents en faveur du country et du folklore. Et de la vieille musique de variétés. Sans ironie. Je peux même donner des cours à vos enfants. Première leçon : la Poune.
[1] La page Wikipédia française du country rap nous dit qu’il est communément appelé crap, mais je pense qu’on se fout de notre gueule ici.
[2] Richard Shusterman, L’art à l’état vif. La pensée pragmatiste et l’esthétique populaire. Paris : Minuit, 1991, 137.
[3] George Revill « Vernacular Culture and the Place of Folk Music ». Social and Cultural Geography 6, 5 (2005) : 694.
[4] Gilbert David, « Théâtre : Le flou artistique », Le Devoir, 30 juillet 2013.
[5] Gérald Godin, « Ils ont inventé le cowboy québécois ». Le magazine Maclean 5, 12 (décembre 1965) : 39.
[6] Sophie Maisonneuve, « Between History and Commodity : The Production of a Musical Patrimony Through the Record in the 1920-1930’s ». Poetics 29 (2001) : 89.
[7] Renault, Philippe. 2008. « Productions XXI : Histoire de se souvenir ». Journal de Montréal, 8 juin 2008.
[8] Richard Baillargeon et Christian Côté. Destination Ragou : Une histoire de la musique populaire au Québec. Montréal : Tryptique, 1991.
[9] Naomi Klein, No Logo. Toronto : Knopf, 2000 : 77-78.
[10] Ibid., 83
[11] Marschal Sella, « Against irony », The New York Times Magazine, 5 septembre 1999.
[12] Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Seuil, 1997, p. 92.