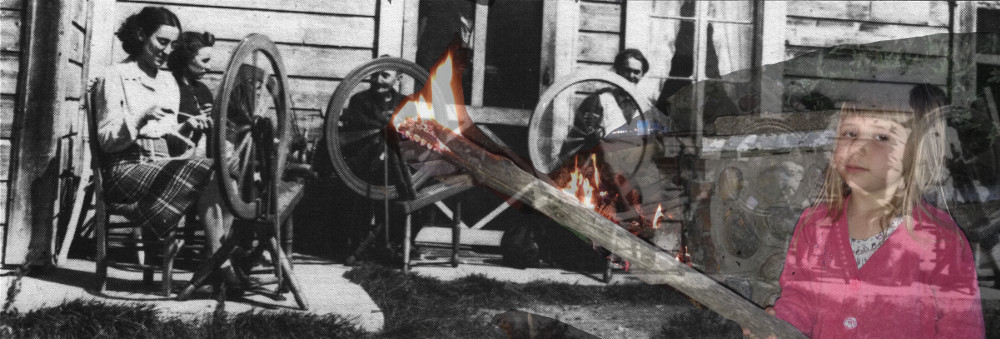Ce qui brûle depuis longtemps. Réponse à « Quelques réflexions sur un feu de paille » de David Dorais
ARIANE GIBEAU
Illustration : Catherine Lefrançois
Le plus récent numéro de la revue L’Inconvénient (nº 76, printemps 2019) prend pour point de départ les polémiques littéraires et culturelles de l’été 2018 (SLAV, Kanata, XYZ. La revue de la nouvelle) et coiffe son dossier de la question suivante : « L’art doit-il être moral? » La position du comité éditorial est claire : non, il ne doit pas l’être, refusons la « censure victimaire » (Roy, 2019, 3), osons tout dire. On trouve donc dans ce dossier un texte de David Dorais, l’auteur de la nouvelle « Qui? Où? Avec quoi? », mise en cause dans le débat XYZ. Cette nouvelle, rappelons-nous, est structurée autour de la prise en chasse et du viol de Miss Scarlet, l’un des personnages emblématiques du jeu de société Clue. Après avoir été blessée par le Professeur Plum qui lui taillade le bras avec un poignard « étroit à sa base et enflé à son extrémité » (Dorais, 2018, 41), Miss Scarlet tente vainement de s’échapper d’un grand manoir et est attaquée par Mr Green. Dans la salle de billard, sous les yeux des autres personnages, celui-ci déchire ses vêtements, la ligote puis observe les différentes armes qui serviront à la violer : « un chandelier, un poignard, une barre de fer, un révolver et une clé anglaise » (Dorais, 2018, 44). En juillet 2018, à la lecture de ce texte, Vanessa Courville, toute nouvelle directrice de la revue XYZ, a demandé que son nom soit retiré du sommaire et que son entrée officielle en poste soit reportée : elle jugeait que le texte de Dorais banalisait la culture du viol et souhaitait s’en dissocier. Le comité éditorial ayant refusé cette demande, Courville a remis sa démission et l’a rendue publique. Un grand débat a suivi, notamment dans Le Devoir et sur les réseaux sociaux. D’entrée de jeu, insistons sur le fait que la nouvelle n’a jamais été menacée de non-publication : Courville préférait énoncer son malaise en s’écartant elle-même du numéro. Il m’apparaît problématique de crier à la censure alors qu’il n’y a eu aucune injonction à refuser la parution du texte et qu’au final, c’est Courville elle-même qui, en démissionnant, s’est privée de « revenus, de pouvoir et de visibilité pour des raisons de conscience » (Lussier, 2019, 167).
Crier à la censure. Crier : hausser le ton, s’emporter. Au plus fort de la polémique, à l’été 2018, les termes employés pour décrire Vanessa Courville et sa dissidence ont été virulents et ont indubitablement contribué à la personnalisation du débat : sur les réseaux sociaux, on a dit qu’elle « mettait le feu », qu’elle répondait à une « doctrine dogmatique », que son discours était « fanatique », voire digne de « nouveaux régimes totalitaires ». Pire, qu’elle était une « hystérique », une « enfant-roi » et une « fauteuse de troubles », et qu’il fallait à tout prix résister au « lynchage » ainsi qu’à la « pureté idéologique annihilatrice qui donne froid dans le dos ». Dans Le Devoir, Patrick Moreau a condamné une prise de position digne de « nouveaux clergés » et n’a pas manqué d’évoquer les censeurs de l’URSS et leur « étroitesse d’esprit doctrinale ». Le comité éditorial de la revue XYZ a justifié son refus de retirer Courville du sommaire par la crainte d’une future direction « capricieuse », « en dents de scie » – souvent femme varie, bien fol qui s’y fie, n’est-ce pas? En dénonçant un geste qu’ils considéraient comme exagéré et inapproprié, plusieurs adversaires de Vanessa Courville sont vite tombés dans une rhétorique elle-même excessive et outrancière. Sa colère à elle était injustifiée et insensée (idéologique), la leur se donnait pour légitime. Tout cela est d’une exaspérante prévisibilité. Une femme prend publiquement la parole pour dire je ne suis pas d’accord d’une manière qui dérange et voilà qu’on l’accuse de frayer avec le totalitarisme : là où elle n’a pas droit de cité, la plus petite colère paraît toujours immense. Les féministes le savent depuis longtemps.
Spectatrice du débat l’été dernier, j’ai souvent eu l’impression que ce n’était pas la littérature qui était mise en examen, mais le féminisme. Je ne m’étonne pas que David Dorais, dans la récente livraison de L’Inconvénient, charge contre cette « idéologie devenue dominante » et tenant « désormais le haut du pavé » (Dorais, 2019, 29). Dans un texte intitulé « Quelques réflexions sur un feu de paille », Dorais revient sur la controverse provoquée par sa nouvelle et la démission de Vanessa Courville. Il explique longuement qu’il n’a pas du tout été affecté par les événements de l’été 2018 : homme bon, collégial et raisonnable (« ceux qui me connaissent savent que je suis plutôt doux et posé, attentionné, attentif à l’autre » [Dorais, 2019, 29]), il affirme en effet avoir été entraîné, à sa grande surprise, dans une affaire ayant des airs de « tempête dans un verre d’eau » (Dorais, 2019, 26). Pourtant, sous l’apparent détachement, on sent rapidement une animosité. Dorais convoque notamment Pascal Bruckner (dont l’autorité intellectuelle en matière de féminisme est d’avoir été accusé à plusieurs reprises de misogynie, de racisme et d’homophobie, et dont la rhétorique incendiaire et injurieuse fait passer la plus emportée des militantes pour une modérée) pour sonner l’alarme : le féminisme prendrait trop de place et, de manière souterraine, incarnerait une menace sociale…
Pire, Dorais prétend que Vanessa Courville aurait mis en place une « fable » (Dorais, 2019, 28) pour attaquer sa nouvelle, sa crédibilité et l’équipe de la revue XYZ. Pour mémoire, rappelons que dans sa lettre de démission, rendue publique sur sa page Facebook en juillet 2018, Vanessa Courville a révélé la réaction de Dorais à son désaccord avec le contenu de la nouvelle « Qui? Où? Avec quoi? » : « L’auteur, quant à lui, émet l’hypothèse que je me suis fait agresser sexuellement et qu’il faudrait que je commence à surmonter ma vulnérabilité pour aborder objectivement les textes littéraires » (Courville, 2018). La présomption d’une agression pour expliquer (et discréditer) sa prise de position a évidemment provoqué l’indignation de nombreuses personnes : « Où sont le respect de la liberté d’opinion, voire de la simple dignité humaine de Vanessa Courville? », a par exemple demandé Lori Saint-Martin (2018) dans Le Devoir.
Or, dans « Quelques réflexions sur un feu de paille », Dorais nie catégoriquement avoir tenu de tels propos et soutient qu’il n’a jamais adressé la parole à Courville. Celle-ci aurait fabriqué cette invitation à mettre de côté ses vulnérabilités. Il l’accuse ainsi d’avoir menti de manière éhontée et dénonce une construction imaginaire, voire une intox :
Mais visiblement, ce qui compte, ce n’est pas de dire la vérité : c’est de créer une bonne histoire. Il est paradoxal de voir triompher la fiction chez des gens si attachés à la réalité et aux impacts que la littérature risque d’y produire. Ce que veut le public, c’est une histoire simple et émouvante, où un héros innocent se retrouve victime de méchants odieux […] Pourquoi tant de gens ont-ils cru aveuglément à une information que rien ne corroborait? Pourquoi ont-ils adhéré avec tant d’enthousiasme à une actualité qu’ils ont vue passer sur leur fil et qui provenait d’une personne que, vraisemblablement, elles connaissaient très peu? C’est que l’histoire faisait leur affaire. Elle leur plaisait. Elle avait une puissance invincible […] Le récit possède le don de dramatiser nos valeurs, de les mettre en action. Ce n’est pas tout d’avoir des idéaux et d’y adhérer in petto : il faut qu’ils servent. Et que ça se voie. Pour ce faire, on peut poser des gestes concrets. Mais il est moins fatigant d’embrasser un récit public qui devient une sorte de scène imaginaire où, par association et par projection, nous nous identifions à un héros (une héroïne dans ce cas-ci) et entrons en action pour faire triompher le bien […] Par une symétrie et un jeu de retournement redoutablement efficaces, notre jeune directrice, dans la fable qu’elle a proposée au public, a d’abord endossé le rôle de la victime féminine, comme dans la nouvelle qu’elle dénonçait, mais pour ensuite se révolter et s’opposer à ses agresseurs. Sous prétexte de préserver la moralité dans la réalité, elle s’est en fait coulée dans ma fiction pour construire un nouveau récit, celui d’une femme forte (Dorais, 2019, 28).
Autrement dit, de nombreuses personnes auraient mordu à l’hameçon d’une fabulatrice, une écervelée en quête de ses 15 minutes de gloire, une personne suffisamment instable émotivement pour s’inventer en personnage de mélodrame. Jeune, par-dessus le marché : le qualificatif revient à plusieurs reprises tout au long du texte, signe qu’être une femme de moins de 30 ans équivaut peut-être, par défaut, à manquer de jugement. On peut évidemment être dubitative devant l’aveu : si Dorais n’a jamais présumé que Courville avait été agressée et n’a jamais jugé qu’elle devait être en mesure d’examiner son texte objectivement, s’il n’existe nulle part aucune preuve, aucune trace de la fabulation (un courriel, par exemple), pourquoi le comité de XYZ. La revue de la nouvelle n’a-t-il jamais contesté l’affirmation de la « jeune démissionnaire »? Pourquoi David Dorais, qui a plusieurs fois pris position sur sa page Facebook, est-il si longtemps resté silencieux à ce sujet? Surtout, qu’aurait à gagner Vanessa Courville en inventant une telle histoire, hormis de la fatigue, de l’anxiété et des insultes? David Dorais prétend-il sérieusement qu’elle a pu se lever un matin en se disant tout bonnement je souhaite mettre ma réputation en péril et perdre toute crédibilité, je vais donc dénoncer un fait inventé? A-t-il idée de la violence de ses mots? Une femme s’exprime, dévoile, s’indigne… et se fait traiter de menteuse : l’air est connu, archiconnu. Mettre publiquement en doute la parole de l’autre parce qu’on se sent attaqué, c’est non seulement odieux et indigne d’un débat intellectuel, c’est encore une fois d’une exaspérante prévisibilité.
D’ailleurs, à lire Dorais, il semble que les féministes disent des sottises, peu importe leur âge. Martine Delvaux, professeure ayant pris position dans Le Devoir au moment du débat, aurait possiblement « déraillé » dans ses propos – et pas pour la première fois :
Tirant dans tous les sens comme elle le fait parfois, elle relie le fait de mettre en scène la violence contre les femmes aux véritables cas de femmes battues, aux réfugiés syriens, aux changements climatiques et à la disparition de l’humanité! Dit-elle vraiment cela? Soit j’ai mal compris, soit elle déraille. Et d’une certaine manière, je serais plus rassuré par le fait de manquer de perspicacité que par l’éventualité qu’une universitaire estimée croie réellement qu’une nouvelle évoquant un viol dans le jeu de Clue fasse fondre les neiges au sommet du Kilimandjaro (Dorais, 2019, 30).
Les féministes non seulement mentent, mais exagèrent et délirent, autre air connu. Que le texte de Martine Delvaux ait invité à reconnaître l’ampleur des meurtres et viols gratuits dans la fiction importe peu, au fond. Je suis un homme doux et posé, elles ont perdu la raison. Cette rhétorique caricature pour mieux délégitimer et reconduit lâchement l’un des grands poncifs de notre imaginaire : les femmes [1], surtout celles qui osent se mettre en colère, sont folles. Exaspérante prévisibilité, disais-je.
Or, la caricature trahit aussi souvent l’ignorance. Qualifier le geste de Vanessa Courville de crise d’enfantillages et de fabulation, c’est visiblement ignorer qu’il s’inscrit dans une tradition théorique cohérente et solide. On pourfend les féministes, on fait d’elles des hystériques fanatiques et pourtant, on s’intéresse peu à ce qu’elles disent véritablement – ou alors on se réfère à Pascal Bruckner pour se convaincre qu’elles errent. Dans le récent numéro de L’Inconvénient, les auteurs rassemblés citent Baudelaire à plusieurs reprises, Shakespeare, Flaubert, Casanova, l’un d’eux convoque même Emmanuel Carrère et Jésus (!) pour discuter d’appropriation culturelle. En revanche, où sont Kate Millett, Anne-Marie Dardigna [2], Barbara Christian? David Dorais et les partisans du « pouvoir tout dire » ne semblent pas savoir que la représentation des violences sexuelles en littérature a été pensée, réfléchie sérieusement par les théoriciennes féministes depuis près de 50 ans. Que la critique littéraire féministe « occidentale » trouve ses fondements dans la dénonciation de violences fictives nouées au réel – car oui, la fiction et le réel se nourrissent l’un l’autre. Que les intellectuelles féministes baignent dans ces questions au quotidien et qu’elles ont peut-être des choses intelligentes à en dire. Et si elles ne souffraient pas de « psychose » (Dorais, 2019, 30)?
On peut être en désaccord, on peut débattre. Mais s’intéresser minimalement au discours de l’autre me semble plus fécond qu’attaquer et adopter une attitude dénigrante, surtout quand on s’indigne que les opinions tournent, à notre époque, en circuit fermé (Dorais, 2019, 27).
Pour les féministes, il ne s’agit pas de contrôler ce qu’on peut ou ne peut pas dire (d’ailleurs, son texte dans L’Inconvénient le prouve, David Dorais dispose de plusieurs tribunes pour nous convaincre qu’il a le droit de dire tout ce qu’il veut). Il s’agit plutôt de comprendre pourquoi, partout, tout le temps, on répète les mêmes scénarios, on revient aux mêmes intrigues mortifères – et c’est bien ce qu’elles ont encore rappelé l’été dernier. Pourquoi la littérature « occidentale » s’érige-t-elle sur le viol, le meurtre et la disparition des femmes? Pourquoi, malgré les progrès féministes du 20e siècle, avons-nous tant de difficulté, encore en 2019, à emprunter de nouvelles avenues dans la création? Pourquoi, quand il s’agit de nos imaginaires, un caillou dans le soulier nous empêche-t-il d’avancer? De jouer et d’inventer? Une critique des violences sexuelles – et on pourrait dire la même chose des violences racistes, homophobes, transphobes, etc., souvent liées du reste – ne pourrait-elle pas se penser sous le signe de la découverte (disons autre chose) plutôt que sous celui de la perte (nous ne pouvons plus rien dire)?
Au Québec, plusieurs travaux fondateurs de la critique au féminin, publiés dans les années 1980, critiquent les violences (sexuelles, physiques, etc.) envers les femmes*. Il n’y a donc pas lieu d’affirmer que la prise de position de Vanessa Courville relève d’une « censure d’un genre inédit » (Roy, 2019, 3, je souligne) – si censure il y a eu. D’entrée de jeu, je reconnais que les travaux ici convoqués, en raison de leur époque et contexte de publication, n’intègrent pas les variables de la « race », de la classe, de l’orientation sexuelle, etc. Une synthèse exhaustive rendant compte de travaux transnationaux plus récents mériterait certainement d’être menée et permettrait de saisir les intersections entre ces variables. Je tiens ici à remonter le temps afin de montrer à quel point la réflexion féministe québécoise à ce sujet n’est pas nouvelle.
Dans « Le meurtre des femmes chez le théologien et le pornographe » (1983), Jeanne Lapointe, intellectuelle injustement méconnue, montre comment, du Malleus Maleficarum, manuel d’inquisition du 15e siècle qui fait de la sorcière un personnage de fiction à part entière, à plusieurs œuvres littéraires contemporaines, les femmes sont régulièrement représentées de manière brutale, voire abjecte : « On pourrait dire que l’ensemble de la littérature et de la culture traditionnelles tend à réduire la femme à l’état d’objet – idéalisé ou méprisé – et aux conditionnements de la soumission, de la souffrance et de l’humiliation, tout comme la pornographie commerciale ou l’éroto-pornographie littéraire » (Lapointe, 1983, 53). L’étude d’un texte temporellement et culturellement très éloigné, et la mise en place d’une filiation permettent à Lapointe de dévoiler ce qui est aujourd’hui une évidence en études féministes : des scénarios bien définis (ici « une même rage de destruction de l’être féminin » [Lapointe, 1983, 43]) imprègnent, voire structurent nos imaginaires.
Car du Malleus Maleficarum à des œuvres lues, célébrées et enseignées encore aujourd’hui, la « rage de destruction » persiste. Le premier article savant de Lori Saint-Martin, publié en 1984 dans Voix et Images, et un chapitre d’Écrire dans la maison du père (1988) de Patricia Smart (intitulé justement « Le cadavre sous les fondations de l’édifice ») sont consacrés au roman du terroir et aux grands textes de la Révolution tranquille : chez Jacques Godbout, Hubert Aquin ou Victor-Lévy Beaulieu, par exemple, le besoin des personnages masculins de s’émanciper d’un ennemi commun (les « Anglais », pour le dire rapidement) trouve inévitablement son envers dans la torture et le meurtre des personnages féminins. Ceux-ci sont assimilés à la terre, à un territoire à posséder pour mieux en triompher, ou encore à une série de monstres terrifiants à affronter. Dans Jos Connaissant, Victor-Lévy Beaulieu fait dire ceci à son narrateur : « [J]e voulais la briser de partout et la détruire […] c’était la seule façon que j’avais de la conserver, de la tuer et de me l’approprier, elle fétiche, elle corps initiatique grâce auquel j’allais me vaincre et m’aimer » (Beaulieu dans Saint-Martin, 1984, 115-116). Il réactive ce faisant un imaginaire de l’abjection à la fois archaïque et éculé. La convocation du Malleus semble soudainement moins tirée par les cheveux… Comme le signale Saint-Martin, « réduire la femme à ne plus être qu’un symbole, c’est nier qu’elle existe en tant qu’être humain autonome » (Saint-Martin, 1984, 117).
Pour les féministes, la littérature a donc le potentiel de reconduire une somme de fantasmes, d’images et de conditionnements. Or, à force de répétitions, il est probable que la représentation de violences ait une incidence sur le réel : celles-ci sont banalisées, voire deviennent gratuites ou sans véritable fonction narrative. Non, un seul texte sur le viol ne constitue pas un appel direct à l’agression – et aucune des féministes ayant pris part au débat XYZ ne l’a suggéré. Par contre, à force de répéter et de répéter, on fait passer pour naturel ce qui ne devrait pas l’être. On ne peut pas prétendre que la lecture en série de viols et de meurtres ne sculptera jamais les pensées des lectrices et des écrivaines, et que celles-ci n’intérioriseront jamais cette violence. À moins de lire très peu de livres écrits par des femmes*.
Insistant sur le fait que le débat de l’été 2018 avait été une sorte de fiction où il s’est retrouvé dans le rôle du « méchant », David Dorais affirme dans « Quelques réflexions sur un feu de paille » qu’il a été jugé parce qu’il était un homme. C’est lui, et non sa nouvelle, qui a été au cœur de la controverse : « Il fallait juger une personne, son sexe, et les idées associées à ce sexe. Pas un texte. Ce qui importe n’est pas ce qui est écrit : c’est le sexe de la personne qui écrit. » (Dorais, 29) Un homme cisgenre blanc d’âge mûr aurait écrit Truismes de Marie Darrieussecq qu’on l’aurait accusé de vouloir « pincer les fesses des jouvencelles » (Dorais, 2019, 29), avance-t-il. Une signature féminine serait perçue, pour le même texte, comme une manifestation de courage, une dénonciation de l’exploitation sexuelle des femmes (Dorais, 2019, 30). Ce qui nous amène au cœur de la problématique : la plupart du temps (j’insiste sur cette nuance), les écrivains et les écrivaines représentent la violence sexuelle différemment. Il est très facile de trouver des œuvres littéraires, canoniques ou non, où le désir sexuel est représenté d’un point de vue masculin, et où ce désir est associé à la possession et à la conquête. Le contraire est beaucoup moins évident. Et la plupart du temps, les signatures ne sont pas interchangeables : autant les œuvres masculines regorgent de violences contre les personnages féminins, autant les œuvres féminines regorgent de violences contre… les personnages féminins. Au Québec, lisez Nelly Arcan, Marie-Célie Agnant, Ying Chen : dans leurs œuvres, dont la parution est pourtant récente, les grandes cibles de la colère et de la violence, ce sont souvent les femmes elles-mêmes. Dans l’essai Entre raison et déraison (1987), France Théoret illustre éloquemment cette asymétrie :
Lorsque je lis certaines pages de Gilbert LaRocque et de Victor-Lévy Beaulieu, précisément celles qui délirent à propos des femmes, je ne peux m’empêcher de penser que ces contemporains sont des hommes de ma génération. Ils projettent leur morbidité sur le corps des femmes. L’inverse me semble impossible. Une femme n’écrit pas à partir du corps masculin pour y projeter son délire, elle écrit son propre délire […] L’homme est à ce point convaincu d’incarner la raison qu’il projette sur l’autre un délire lui appartenant, un délire auquel il fait face par la médiation […] Il n’y a qu’un seul corps de fantasmes pour l’un et l’autre sexe : le corps féminin. L’écriture des femmes tend, très souvent, à parler des femmes. Ce n’est ni par un effet de limitations de l’esprit des femmes ni par insuffisance d’identité. Ce n’est pas non plus faute de connaître les hommes. L’homme s’est placé en position de maîtrise et de savoir, toujours suffisamment pour rendre indécidable sa position d’altérité (Théoret, 1987, p. 37-39).
Ce « corps de fantasmes » commun crée donc une forme de disparité : d’un côté on perpètre plus souvent, de l’autre on subit plus souvent. Malgré les nuances et les contre-exemples, il existe de grands schémas qui en disent long sur ce qui nous nourrit collectivement. Et qui font que la violence d’un personnage féminin dans une œuvre écrite par une femme* ne sera pas portée, la plupart du temps, par les mêmes objectifs que la violence d’un personnage masculin dans une œuvre écrite par un homme cisgenre. C’est ce que les féministes observent et questionnent en lisant les œuvres, comme l’a notamment rappelé Isabelle Boisclair l’été dernier : à quoi sert la représentation du viol? Et non, les lectrices féministes ne cherchent pas à tout prix une critique de la violence surlignée au fluo et accompagnée de néons clignotants. Elles savent faire de l’analyse littéraire : elles observent le choix de la focalisation et des métaphores, la force des images, la position de l’instance auctoriale, la présence ou non d’agentivité chez le personnage agressé, etc. Elles sont même capables de nuance : elles savent saisir les tensions et les non-dits d’une œuvre. Non, elles n’interdiront pas la lecture de la nouvelle de David Dorais – je l’ai d’ailleurs moi-même enseignée à l’UQAM à la session d’automne 2018. Cependant, on peut s’attendre à ce qu’elles invitent à reconnaître l’immense différence entre la subversion de clichés et leur grossière reconduction.
***
Prétendre que la littérature doit être libre tout en se cantonnant toujours aux mêmes motifs relève d’un curieux paradoxe. Je nous souhaite donc d’exiger mieux. À David Dorais qui demande, dans L’Inconvénient, qu’on lui explique ce à quoi la littérature devrait ressembler au lieu de « chercher à museler les blasphémateurs » (Dorais, 2019, 34), je réponds simplement ceci, au risque de répéter ce que plusieurs ont affirmé bien avant moi : à un lieu où le viol est questionné et pris au sérieux. Où il est reconnu comme menace véritable dans le monde réel. Où les personnes s’identifiant comme femmes ou appartenant à des groupes minorisés ne sont plus continuellement reléguées à des symboles éculés. Il y a énormément à aller puiser là, sans que les œuvres deviennent « morales » ou vertueuses. Je nous souhaite de reconnaître enfin le travail mené par les critiques littéraires féministes depuis plusieurs décennies (et ses transformations au fil du temps). Je nous souhaite de poursuivre le débat sans attaque diffamatoire ni textes calomnieux. Surtout, je nous souhaite que la démission de Vanessa Courville ne soit pas vaine. Qu’elle nous fasse avancer, plutôt.
Bibliographie
Boisclair, Isabelle. 2018. « Représentation du viol en littérature : pour dire quoi? », Le Devoir, 27 juillet [en ligne].
Courville, Vanessa. 2018. « Lettre de démission » [en ligne].
Dardigna, Anne-Marie. 1980. Les châteaux d’Éros ou les infortunes du sexe des femmes, Paris : La Découverte, coll. « Petite bibliothèque Maspéro », [en ligne].
Delvaux, Martine. 2018. « Pas de refuge pour les femmes », Le Devoir, 25 août [en ligne].
Dorais, David. 2019. « Quelques réflexions sur un feu de paille », L’Inconvénient, nº 76, p. 26-40.
Dorais, David. 2018. « Qui? Où? Avec quoi? », XYZ. La revue de la nouvelle, nº 135, p. 40-44.
Lapointe, Jeanne. 1983. « Le meurtre des femmes chez le théologien et le pornographe », Les cahiers du GRIF, nº 26, p. 43-53.
Lussier, Judith. 2019. On ne peut plus rien dire. Le militantisme à l’ère des réseaux sociaux, Montréal : Éditions Cardinal.
Moreau, Patrick. 2018. « Oui à la liberté de l’artiste, non aux tentatives de censure », Le Devoir, 30 juillet, p. A7.
Roy, Alain. 2019. « Les inconvénients de la censure victimaire », L’Inconvénient, nº 76, p. 3-4.
Saint-Martin, Lori. 1984. « Mise à mort de la femme et libération de l’homme : Godbout, Aquin, Beaulieu », Voix et Images, vol. 10, nº 1, p. 107-117.
Saint-Martin, Lori. 2018. « De la responsabilité des écrivains », Le Devoir, 28 juillet [en ligne].
Smart, Patricia. 1988. Écrire dans la maison du père. L’émergence du féminin dans la tradition littéraire au Québec, Montréal : Québec Amérique.
Théoret, France. 1987. Entre raison et déraison, Montréal : Les Herbes rouges.
[1] J’inclus ici toutes les personnes qui s’identifient comme femmes. L’astérisque qui accompagnera les prochaines occurrences du mot « femmes » dans le texte rendra compte de cette inclusion.
[2] Dans Les châteaux d’Eros, publié en 1980 (il y a donc 40 ans), Anne-Marie Dardigna anticipe que toute critique féministe sera perçue comme une tentative de censure : « Probablement, on ne manquera de crier haro sur ce que l’on appellera une censure féministe, castratrice et terroriste. S’il y a eu terrorisme jusqu’à présent, n’est-ce pas sur les femmes qu’il a pesé? […] Notre imaginaire, nos rêves et nos fantasmes, notre solitude et le désir de les communiquer ne compteraient donc pour rien? Curieuse dénégation de ce qu’une écriture, une fiction peuvent traverser de manière incontrôlée et incontrôlable, mais bien réelle, la conscience (et parfois même les pratiques) de toute une génération. » Voir Dardigna [en ligne].