8. Science, université, savoir, vérité et objectivité
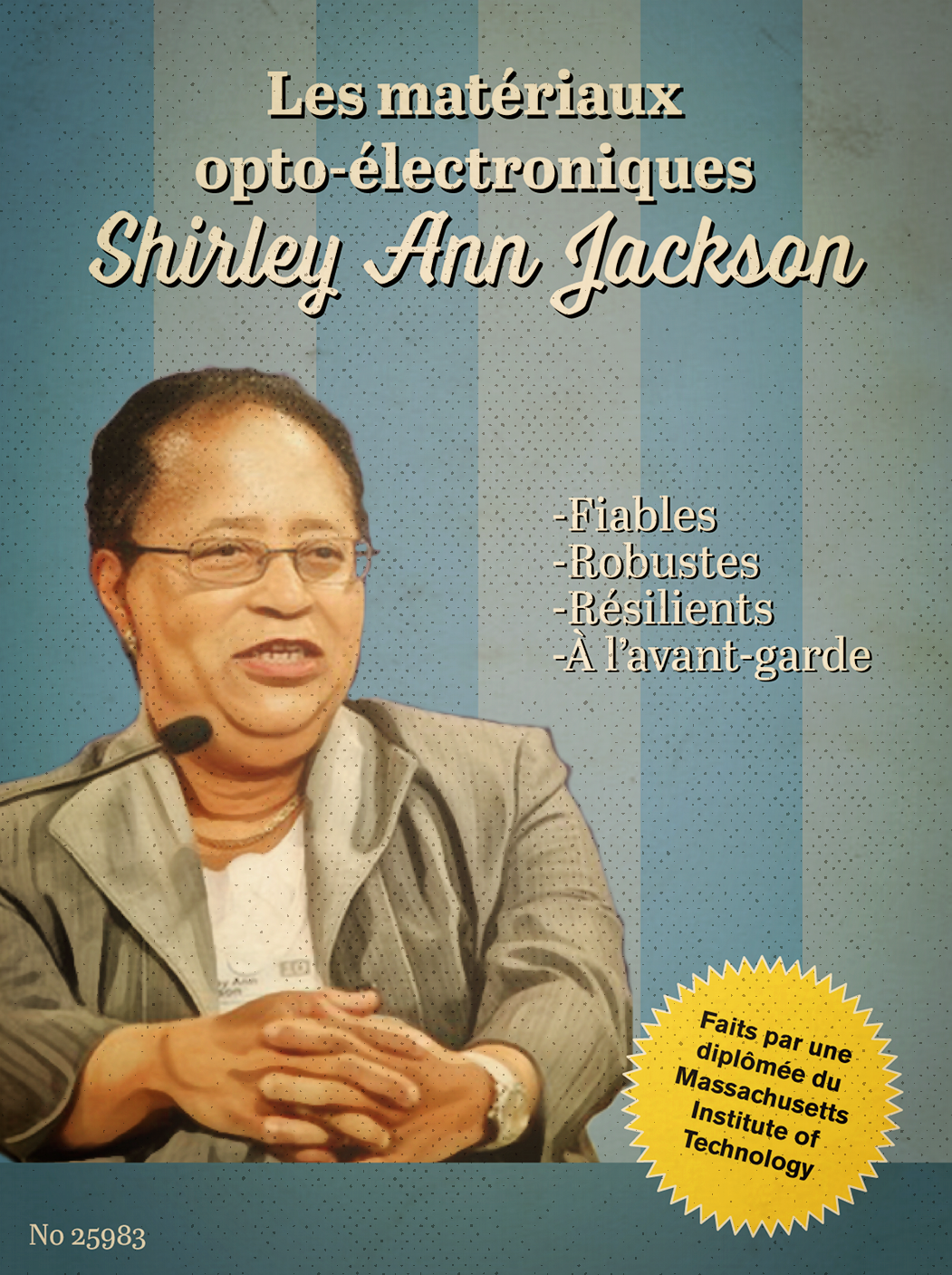 Pierre-Luc Landry
Pierre-Luc Landry
Dire « je » à l’université : voilà une idée révolutionnaire. Une idée qui ne devrait pourtant pas être aussi subversive qu’elle le semble en ce moment puisque le savoir, de tout temps, dans toutes les disciplines, n’existe pas sans orientation, sans être situé. Mon expertise à moi, bien petite et modeste, concerne la littérature, donc l’univers des humanités, des arts, des lettres, des sciences humaines et sociales. J’écris par conséquent depuis cette perspective particulière, ignorante de bien des modalités propres aux sciences de la santé, aux sciences de la terre, au génie et aux sciences appliquées. J’ose tout de même prétendre que le médecin, la chimiste, la physicienne ou le géologue partagent avec leurs collègues des facultés plus « molles », pour reprendre le cliché éculé et méprisant, une certaine humanité. En effet, cachés derrière un « nous » auctorial, derrière des données supposément neutres, la politologue, le critique littéraire et la sociologue, au même titre que leurs homologues de sciences et génie, sont absolument capables d’objectivé; néanmoins, ils n’en sont pas pour autant des êtres objectifs – la nuance est essentielle –, ni des esprits purs, des machines à réfléchir et à analyser pour qui le monde social n’existerait pas, qui seraient né·e·s et auraient grandi en vase clos, sans être formé·e·s par la doxa et ses discours dominants, sans avoir quelque relation que ce soit avec la culture, les institutions et le pouvoir.
Ma perspective, à plus forte raison, est celle d’un homme blanc cisgenre hautement scolarisé et privilégié sur un nombre infini d’aspects. Il est important de le considérer. Mon discours n’est pas neutre. Surtout : il n’existe aucun discours neutre. Chaque prise de parole émerge d’un lieu d’énonciation dont les contours sont essentiels à la compréhension des différentes idéologies qui y sont à l’œuvre.
J’aimerais, par ces notes trop courtes, mettre de l’avant les réflexions sur le sujet de la part de quelques théoriciennes qu’il m’a été donné de lire récemment, dont le travail participe d’un certain renouvellement de la science qu’il est urgent d’appeler de nos vœux et, surtout, de mettre nous-mêmes en place.
bell hooks
Dans l’introduction de son ouvrage sur L’imaginaire hétérolingue, Myriam Suchet choisit, l’espace de quelques pages, de faire usage du « je » afin de « dissiper l’illusion de la chercheuse objective et extérieure à son travail » (2014 : 33). Inspirée par les théories postcoloniales, Suchet insiste sur l’importance de « reconnaître que nous pensons toujours de manière située, car c’est à partir d’une situation qu’une connaissance est possible, même si cette connaissance n’est pas réductible aux conditions de son élaboration » (2014 : 33). La « prétention à la neutralité scientifique » ne semble plus possible aujourd’hui, notamment puisque le postcolonialisme a montré que l’universalisme n’est toujours que l’expression d’un sujet collectif hégémonique qui se pose lui-même comme universel stable et invariable.
La théorie du standpoint suggère de plus qu’il n’existe que des savoirs situés, partiaux et incomplets; bell hooks, dans Teaching to Transgress, propose de mettre cette idée à contribution dans la relation entre le professeur ou la professeure, savant·e incontesté·e et spécialiste de « son » sujet, et les étudiant·e·s qui s’abreuvent à son savoir. En effet, puisque nous pensons toujours de manière située, un enseignement qui fait de la place à l’expérience – paramètre si important de la méthode scientifique que l’on tend toutefois à oublier très vite en dehors du laboratoire – permettrait « d’améliorer notre capacité à connaître » (hooks, 1994 : 148; ma traduction). Ron Scapp, l’interlocuteur de bell hooks dans ce chapitre de son ouvrage, ajoute qu’un tel partage d’expériences personnelles à l’université « permet aux étudiant·e·s de revendiquer un socle de connaissances à partir duquel ils·elles peuvent s’exprimer » (1994 : 148; ma traduction). En ce sens, donc, hooks milite pour une science qui n’ignore pas volontairement que les êtres humains sont aussi faits d’émotions : « The restrictive, repressive classroom ritual insists that emotional responses have no place. Whenever emotional responses erupt, many of us believe our academic purpose has been diminished. To me this is really a distorted notion of intellectual practice, since the underlying assumption is that to be truly intellectual we must be cut off from our emotions. » (1994 : 155).
Ce partage pédagogique, favorisant l’apprentissage, n’est toutefois pas à sens unique, chez hooks. Elle invite en fait les professeur·e·s à exposer leur vulnérabilité, à prendre des risques. « Engaged pedagogy does not seek simply to empower students », écrit-elle (1994 : 21). « Ceux et celles qui s’attendent à ce que les étudiant·e·s partagent leur histoire personnelle mais qui sont peu disposé·e·s au partage eux-mêmes et elles-mêmes exercent leur pouvoir de manière coercitive », précise-t-elle aussi (1994 : 21; ma traduction). Pour qu’une telle pédagogie fonctionne, il faut que les professeur·e·s se mettent en danger d’abord, faisant le premier pas vers l’instauration d’un nouveau rapport de pouvoir, plus horizontal, « afin de montrer [à la classe] de quelle manière les expériences personnelles peuvent illuminer et rehausser notre compréhension du matériel théorique » (1994 : 21; ma traduction).
La reconnaissance de la vulnérabilité des professeur·e·s ouvre une véritable boîte de Pandore qui, une fois déballée, pave la voie à la remise en cause de la culture de la vitesse dans le monde universitaire. Et c’est tant mieux.
Maggie Berg et Barbara K. Seeber
C’est à cette tâche herculéenne que Maggie Berg et Barbara K. Seeber s’attellent dans leur ouvrage The Slow Professor. Il est impossible de rendre justice à leur texte en quelques lignes seulement; leur manifeste pour plus de lenteur ainsi que leurs fines analyses des problèmes actuels de l’institution universitaire sont essentiels pour quiconque œuvre à l’université ou entend y passer un moment, étudiant·e·s comme professeur·e·s, chercheur·e·s et – surtout – administrateurs·trices. Je voudrais en dire quelques mots, ne serait-ce que pour souligner le courage et l’honnêteté avec lesquels Berg et Seeber se sont livrées à un exercice difficile d’humilité, de fragilité et d’intimité absolument nécessaire pour repenser la science et ses institutions.
Leur ouvrage émerge des difficultés ressenties dans l’exercice de leurs fonctions, et a demandé de leur part un certain mépris du danger, puisqu’elles énoncent ainsi ce que d’aucuns pourraient considérer comme une incompétence fondamentale : « Academic training includes induction into a culture of scholarly individualism and intellectual mastery », écrivent-elles en introduction; « to admit to struggle undermines our professorial identity. The academy as a whole has been reticent in acknowledging its stress; to talk about the body and emotion goes against the grain of an institution that privileges the mind and reason » (2016 : 2). Considérant la pratique individuelle de leur profession comme un lieu de résistance, Berg et Seeber plaident pour une perturbation en profondeur du modèle corporatif appliqué à l’université, avec tout ce qu’il inclut de vitesse et de pression abusives. Elles réclament, pour les professeur·e·s et les étudiant·e·s à qui ils et elles enseignent (donc, par extension, pour la science), le droit à la santé (physique et mentale) et le droit à la vie privée; le manque de temps dont les scientifiques souffrent « n’est pas uniquement un problème individuel. Il est néfaste au travail intellectuel puisqu’il interfère avec notre capacité à penser de manière critique et créative » (2016 : 17; ma traduction). S’opposant au temps du monde des affaires, Berg et Seeber proposent que l’université a besoin d’exister à l’extérieur du temps, dans ce qu’elles nomment une « intemporalité » propice au travail intellectuel et scientifique. Elles refusent par le fait même les différentes « stratégies gagnantes » de gestion du temps, et suggèrent de permettre aux professeur·e·s, à l’université, d’en faire moins, d’une part, et de s’investir davantage, d’autre part, dans une pédagogie instruite par le plaisir, ainsi que dans une plus grande collégialité avec les collègues. En ce sens, leur programme n’est pas très éloigné de celui de bell hooks.
Citant Margaret Blackie, Jennifer Case et Jeff Jawitz, Berg et Seeber réclament un environnement où les intellectuel·le·s et les scientifiques peuvent être vulnérables et explorer leurs incertitudes et leurs doutes (2016 : 33); en effet, l’émotion, à leur sens, peut faire de l’obstruction au programme global de l’université corporative (2016 : 34). Pour les deux autrices, comme pour bell hooks avant elles, l’intelligence a besoin d’un corps dans lequel s’incarner, et l’insistance des discours prononcés autour de la science sur l’autosuffisance de l’esprit « a des effets délétères sur [l’]enseignement » et la vie des professeur·e·s; elles suggèrent alors, pour le bénéfice des étudiant·e·s qui apprennent en grande partie grâce aux émotions ressenties lors du contact avec un nouveau savoir, de faire de l’université et de la science des endroits positifs (2016 : 34-35) où penser en collectifs, de manière éthique, en faisant de la place aux autres et à l’altérité (2016 : 58-59).
Une telle collégialité est garante de plus d’attention et de soin, de care. La relation pédagogique se joue d’individu à individu; ainsi, il est nécessaire qu’elle se déroule dans le respect, dans l’écoute, dans l’ouverture, et un environnement positif où le professeur ou la professeure va bien, littéralement – c’est-à-dire qu’il ou elle n’est pas sur le point de craquer –, favorise le dépassement de soi. Ainsi, la résistance que prônent Berg et Seeber par rapport à la transformation de l’université en entreprise à but lucratif leur permet d’envisager le futur de la science et de ses institutions avec espoir : la culture peut changer, affirment-elles (2016 : 84).
Conclusion
Nous avons besoin d’affirmer, au sein même des institutions du savoir, que celui-ci n’est pas objectif et neutre. Nous avons besoin aussi de penser la science autrement, de comprendre que le savoir est situé, de réinvestir la salle de classe, de placer les étudiant·e·s au centre de la mission de l’université, et d’imaginer un espace de réflexion et de création qui n’étouffe pas ses professeur·e·s sous des demandes et des contraintes déshumanisantes. Myriam Suchet, bell hooks, Maggie Berg et Barbara K. Seeber nous y invitent, chacune à sa façon. Elles ne sont pas seules, bien entendu; les ouvrages sur la crise des institutions universitaires et des disciplines sont légion. Mais rares sont ceux qui mettent de l’avant les émotions et la vulnérabilité. Ces textes sont, la plupart du temps, écrits par des femmes. Je ne proposerai pas d’explication à ce « phénomène »; il me semble de toute manière qu’il est assez simple à comprendre (en surface, à tout le moins). Ne dit-on pas souvent qu’en politique les femmes font les choses autrement, lorsqu’elles ne se contentent pas de reproduire les comportements « masculins » toxiques hégémoniques, qu’elles les remettent plutôt en question? Parce que ce sont elles qui ont tout à perdre, peut-être, et qu’au jeu de quitte ou double la prudence ne sert plus à rien. Mais qu’est-ce que j’en sais, au fond? J’en sais seulement que les textes cités ici, dans ces notes, que j’espère d’ailleurs avoir traités avec la considération qu’ils méritent, suggèrent qu’il est urgent de faire descendre la science et le savoir de leur piédestal, non pas pour en atténuer le prestige, mais bien plutôt pour les envisager comme des activités humaines, donc empreintes d’idéologies, et de les rendre accessibles au plus grand nombre, dans l’esprit de l’avancement des connaissances.
Bibliographie
BLACKIE, Margaret A.L., Jennifer M. CASE et Jeff JAWITZ (2010). « Student-Centredness: The Link between Transforming Students and Transforming Ourselves », dans Teaching in Higher Education, volume 15, numéro 6 : 637-646.
BERG, Maggie et Barbara K. SEEBER (2016). The Slow Professor. Challenging the Culture of Speed in the Academy, Toronto : University of Toronto Press.
HOOKS, bell (1994). Teaching to Transgress. Education as the Practice of Freedom, New York : Routledge.
SUCHET, Myriam (2014). L’imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, Paris : Classiques Garnier (Perspectives comparatistes).
