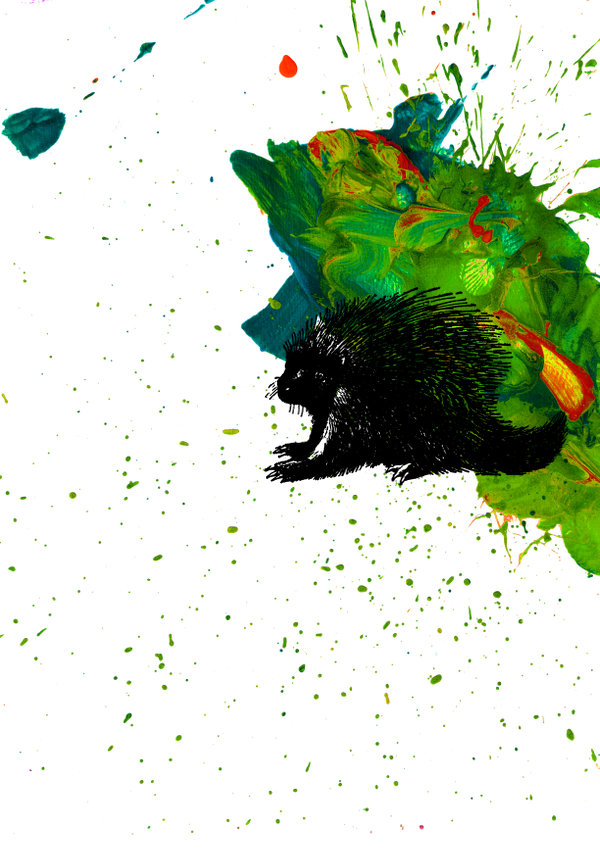3. Je rêve d’un immense tremblement de terre
PIERRE-LUC LANDRY
« Listen up, women are telling their story now », écrit Rebecca Solnit dans un article publié par The Guardian le 30 décembre dernier[1] – article répertorié dans la série « The long read » et dans la section « Feminism », mais, surtout et fort malheureusement, publié dans la sous-division « Women » de la portion « Lifestyle » de leur site Web. Dans ce texte sur lequel je reviendrai sans aucun doute, Solnit rappelle les nombreuses prises de parole féministes de 2014 et postule que le monde et que la culture sont en pleine mutation grâce aux dénonciations dont cette année charnière aura été le théâtre, grâce à une sorte de ras-le-bol libérateur au potentiel incroyable. « […] [T]he world has changed », écrit-elle encore; « the most important thing is that it has ». Oui. Sans aucun doute. Mais j’entame 2015 dans la colère. Je suis en colère à cause de notre indifférence collective face à ces Amérindiennes qui disparaissent par milliers au Canada, face à ces adolescents noirs qui sont assassinés aux États-Unis, face à ces écolières au Nigéria qui ont probablement été réduites à l’esclavage par Boko Haram, face à ces jeunes transsexuels qui ne savent plus vivre à cause de l’hostilité de leur entourage, et ainsi de suite. Il n’existe pour moi pas d’autre manière d’être-au-monde, en ce moment, sinon celle-ci : une colère killjoy face au caractère sélectif de notre capacité à l’indignation; une colère trouble-fête aux yeux de ceux qui se félicitent d’être « militants 2.0 »; une colère d’empêcheur de penser en rond, peut-être, face au consensus social positiviste. Une colère sourde par rapport aux médias de masse qui forgent une opinion publique confortable et imperturbable. J’expliquerai pourquoi, dans ces notes, je rêve d’un immense tremblement de terre.
+++
« This issue is not a women’s issue, this is not an Aboriginal issue. This is a human tragedy, and this is a national disgrace », a affirmé Dawn Harvard, présidente intérimaire de l’Association des femmes autochtones du Canada, dans un discours prononcé lors d’un rassemblement à Ottawa le 4 octobre 2013. Ces deux phrases ouvrent Sœurs volées, livre d’Emmanuelle Walter publié en novembre 2014 chez Lux Éditeur[2]. Dans cet ouvrage, Walter enquête sur la disparition ou le meurtre de près de 1200 Amérindiennes canadiennes depuis 1980, à partir de l’exemple de deux jeunes filles de Kitigan Zibi, près de Maniwaki, disparues en 2008. « Quand des femmes meurent par centaines pour l’unique raison qu’elles sont des femmes et que la violence qui s’exerce contre elles n’est pas seulement le fait de leurs assassins mais aussi d’un système; lorsque cette violence relève aussi de la négligence gouvernementale, on appelle ça un féminicide », écrit Walter. Un féminicide, oui, même si le terme n’existe pas encore, officiellement, dans la langue française. Jules Farquet rappelle, dans un texte sur Ciudad Juárez, les deux dimensions caractérisant le féminicide selon l’anthropologue Marcela Lagarde : « il s’agit d’un crime de genre, misogyne, de haine contre les femmes qui jouit d’une grande tolérance sociale; et l’État joue un grand rôle dans son impunité, qui constituerait l’une de ses caractéristiques majeures[3] ». Lorsque Stephen Harper annonce qu’il faut regarder les cas des femmes autochtones disparues ou assassinées comme des « crimes » et non pas comme parties d’un même phénomène sociologique, l’État se rend complice de quelque chose comme un génocide de genre, donc qui demeure impuni socialement dans la mesure où les véritables coupables – c’est-à-dire le racisme, l’indifférence de la population et des médias, le colonialisme, l’aveuglement collectif, l’ignorance, la misogynie, la vulnérabilité des populations à risque, la pauvreté et les traumatismes historiques, par exemple – ne sont pas identifiés ou sont balayés sous le tapis en attendant la prochaine prise de conscience collective, qui ne durera de toute façon qu’un certain temps.
« Le monde autochtone est étranger aux Canadiens, écrit encore Walter, plus encore sans doute que le sont les immigrés venus d’Asie ou d’Afrique; le ressentiment est puissant envers ces Premières Nations auxquelles on reproche de ne pas adhérer au pacte social tout en dépendant des subsides fédéraux qu’ils sont accusés de gaspiller, dont on ne comprend pas que les villages soient parfois dignes du tiers-monde à quelques kilomètres de très prospères mines de pétrole, dont les destinées sont souvent marquées par le malheur même quand, parfois, les moyens financiers sont là, comme chez les Cris de la Baie-James; dont les hommes et les femmes sont surreprésentés dans le système carcéral. Ainsi, la difficulté à s’identifier, une forme de stupéfaction amère devant le fossé culturel en dépit de plus de quatre cents ans de cohabitation, l’ignorance des spoliations et du traumatisme des pensionnats… alimentent ce silence. » C’est contre ce silence ethnocentriste que je suis en colère (en plus d’être en colère contre le système autorisant le féminicide, bien évidemment). Je suis en colère parce que nos médias ne s’intéressent à l’horreur que dans la mesure où elle est spectaculaire et immédiate; je suis en colère parce que nous laissons ces mêmes médias dicter ce qui devrait nous préoccuper (ou pas); je suis aussi en colère parce que nous nous sommes collectivement dédouanés de notre responsabilité en portant la plume rouge sur nos vêtements et en utilisant le mot-clic #IdleNoMore lorsque cela était « tendance », « trending on Twitter ».
Heureusement, il existe de ces gens qui forcent la tendance et qui, par leurs actions et leurs prises de parole, nous obligent à reconsidérer notre indifférence. Emmanuelle Walter en est une et son livre ne peut que nous rappeler à l’ordre. Idle No More, en tant que mouvement autogéré, a plus de deux ans d’existence. Néanmoins, les rassemblements les plus importants organisés dans la foulée du mouvement auront eux aussi deux ans bientôt. Malgré le « momentum » de 2013, le rapport de l’organisation Human Rights Watch sur les « abus policiers et lacunes dans la protection des femmes et filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique », malgré la commission Oppal, malgré l’enquête de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et malgré les discours et rappels à l’ordre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, aucune action pancanadienne concertée n’aura été engagée, les gouvernements provinciaux et municipaux se contentant de rappeler aux journalistes avec grande froideur que la « question amérindienne » est de juridiction fédérale. Emmanuelle Walter écrit en 2014 pour celles que l’on ne peut pas entendre, bien sûr, mais aussi pour celles que l’on ne veut pas entendre. La misère des communautés amérindiennes ne touche pas les grands publics puisqu’elle n’est pas occidentale, après tout; elle ne nous concerne pas.
J’ai enseigné pendant un semestre à Maniwaki. Le matin, en traversant Kitigan Zibi, avant d’arriver au boulot, je voyais les visages de Maisy Odjick et de Shannon Alexander sur le grand panneau posé aux abords de la route 105. J’ai aussi eu, parmi mes étudiants à Gatineau et à Hull, plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes de Kitigan Zibi, des Anishinabés comme Maisy et Shannon, qui connaissaient sans doute les deux jeunes femmes disparues. Mais nous n’en parlions pas. À l’époque, je ne savais même rien de l’horreur qui se déroulait pourtant tout juste à côté. Nous n’avions pas « l’excuse » facile de la distance pour racheter bien stupidement notre ignorance. Mais cette excuse, de toute manière, était inutile; du féminicide personne ne parlait, ni les médias, ni nous.
Très récemment, l’illustrateur Evan Munday s’est engagé, lui aussi, à attirer l’attention sur les 1200 cas de femmes autochtones assassinées ou disparues. À partir d’une base de données de la Gendarmerie royale du Canada, il réalisera chaque jour un portrait à l’encre et au crayon d’une des victimes et fera parvenir le dessin à Stephen Harper afin d’attirer son attention sur l’urgence de la situation, sur l’importance d’agir tout de suite. « I wanted it to be taking time and effort, a affirmé Munday au Toronto Star. It actually makes me think more about it. It makes me think more about both the issue and that these are people who have gone missing or who have died and think about their lives[4] ». Au même moment, Radio-Canada apprend qu’un agent de la Gendarmerie royale du Canada aurait écopé l’an dernier d’une sanction équivalant à sept jours de son salaire pour avoir libéré de détention une femme amérindienne de la nation crie Nisichawayasihk afin d’avoir des rapports sexuels avec elle, chez lui. L’histoire est malheureusement déjà tombée dans l’oubli.
Et moi, dans tout cela? Moi, je fais quoi? Je peux faire quoi? Je lis. Je lis beaucoup. Je lis ces femmes et ces hommes autochtones qui prennent la parole sur les petites tribunes dont ils et elles disposent, sur Internet. Mais je ne suis pas très au fait du grand mouvement de décolonisation qui se trame peut-être quelque part. Je lis les journaux, comme tout le monde, et par moments, sur Facebook, au restaurant, je m’insurge. Mais pas trop fort, et pas trop longtemps. Je vis, moi aussi, dans le confort du consensus social qui me ravale constamment.
+++
« Il faut des morts. II faut de l’extrême violence pour que notre mollesse collective se fige enfin. Il faut la stupeur puisqu’à force de confort, on perd l’habitude des postures exigeantes que nécessite la défense d’idéaux », écrit David Desjardins dans Le Devoir[5]. Et l’extrême violence, c’est celle du charnier de Charlie Hebdo qui aura définitivement ouvert l’année médiatique 2015. Cette fois, l’horreur a frappé « près de la maison ».
Voilà que les médias sociaux se déchaînent. « Alors, dans l’effarement, parce qu’il faut toujours dire quelque chose, nous proférons toutes sortes de conneries faussement chargées de sens », écrit encore David Desjardins. Je vois défiler de ces conneries sur mon écran, ponctuées bien sûr par de véritables réflexions, mais beaucoup de bêtises ainsi que certains appels à « ne pas réfléchir tout de suite », à prendre le temps de vivre le deuil. Mais on ne parle pas des mosquées attaquées, des agressions islamophobes ayant lieu un peu partout en France dans l’immédiat « post-Charlie ». On parle plutôt d’un « 11 septembre français » sans faire attention aux mots débiles que l’on emploie. On change sa photo de profil, on utilise le mot-clic à la mode et on se réclame soudainement, pour la plupart, d’un journal satirique dont on n’avait jamais entendu parler ou qu’on ne lisait pas.
Je suis perméable à la douleur des autres, à leur indignation; je me sens obligé de réagir, de dire quelque chose à mon tour, de porter le noir, d’« être Charlie ». « Nous ne serons jamais Charlie tant que nous préférons la gentillesse au choc des idées, écrit David Desjardins. Tant que nous n’aurons pas le courage de comprendre qu’il faut surtout défendre ceux qui ne partagent pas nos points de vue. Défendre leur droit d’exister, même s’ils sont cons comme des manches, qu’ils choquent. Justement parce qu’ils choquent. Mais on peut aussi espérer que ce drame ne sera pas parfaitement inutile. Qu’il ne nous tirera pas vers le bas et que ces abrutis armés jusqu’aux dents, plutôt que de nous faire peur, nous secouent avec une telle violence que nous réalisions enfin que nos petits renoncements s’additionnent, jusqu’à la faillite. » J’ai de la difficulté à comprendre la consternation sélective de mon entourage immédiat et des masses qui s’expriment sur les réseaux sociaux; je comprends mal aussi le deuil collectif aux critères ethnocentriques, l’« engagement » politique qui se résume à des mots-clics. Bien sûr, je suis choqué par ce qui s’est passé à Paris. L’événement influencera très certainement la manière dont je continuerai à réfléchir au monde. Mais mon engagement, aussi bourgeois soit-il, n’exige pas que je change ma photo de profil. D’autant plus que je ne connais pas assez le Charlie Hebdo pour m’en réclamer immédiatement. Faut-il comprendre que la tendance, cette fois, n’a comme but que l’expression d’une solidarité sans frontières avec les victimes et leurs familles, avec le peuple français ébranlé par l’attaque? Doit-on immédiatement évacuer tout contenu politique de cette prise de parole 2.0 pour ne lui accorder qu’une valeur de sentiment?
Deux jours plus tard, Boko Haram tue près de 2000 personnes dans la ville de Baga, au Nigeria. Près de 10 000 personnes ont été assassinées par le groupe armé, en 2014 seulement, selon certaines estimations. L’opinion publique occidentale aura été touchée pendant quelques semaines par l’enlèvement d’environ 300 écolières près de la ville de Chibok, en avril 2014. Néanmoins, six mois après que le mot-clic #BringBackOurGirls eut cartonné sur Twitter et Facebook, au point où Michelle Obama aurait elle-même posé avec une affichette scandant la célèbre formule, aucune action diplomatique n’a été mise sur pied afin de secourir les jeunes femmes, dont 219 sont toujours en captivité – probablement mariées de force, vendues, réduites en esclavage, etc. Mkeki Mutah, l’oncle de deux jeunes filles enlevées, pose une question essentielle quant aux promesses de la communauté internationale; pourquoi celle-ci se contente-t-elle de parler, pourquoi n’agit-elle pas? « Leaders from around the world came out and said they would assist to bring the girls back, affirme-t-il dans une entrevue accordée à Al Jazeera[6], but now we hear nothing. The question I wish to raise is: why? » 250 jours plus tard, le point de mire des médias occidentaux – et de la population par le fait même – s’est tourné vers Ebola et ISIS. Néanmoins, le tourbillon médiatique entourant l’épidémie de fièvre hémorragique se sera lui aussi rapidement calmé lorsque la menace aura cessé de peser sérieusement sur l’Occident : plus de 8000 morts en Afrique de l’Ouest, mais peu de propagation en Europe ou en Amérique; passons au prochain appel. François Hollande, Angela Merkel, David Cameron, Mahmoud Abbas, Benyamin Netanyahou, Abdallah II et Rania de Jordanie, Steven Blaney : près de quarante-cinq dirigeants d’un peu partout dans le monde se sont rendus à Paris le 11 janvier 2015 pour manifester contre les attentats de Charlie Hebdo. Combien se sont rendus au Nigeria ou ont offert une véritable assistance au gouvernement (plutôt inactif, selon la critique) de Goodluck Jonathan dans la lutte contre Boko Haram?
+++
Notre indignation est sélective. Et nous nous dédouanons d’un véritable rôle citoyen par notre utilisation de « mots-clics » engagés que nous nous empressons ensuite d’oublier. Je reviens à Rebecca Solnit et à son article sur 2014, l’année où les femmes ont pris la parole pour raconter leur(s) histoire(s). Elle rappelle dans son texte les « grandes tendances » de 2014 : le harcèlement sur Internet en janvier; les jeunes filles enlevées par Boko Haram en avril; #YesAllWomen en mai, comme une réponse au sempiternel « Not all men are rapists… »; le #WhyILeft et le #WhyIStayed de septembre, à la suite de la vidéo montrant Ray Rice tabassant sa femme dans un ascenseur à Atlantic City; « l’affaire Ghomeshi » en octobre – avec le mot-clic #AgressionNonDénoncée et son prédécesseur #BeenRapedNeverReported; etc. À chaque mois son « scandale », à chaque mois son indignation, aussitôt oubliée parce qu’on a autre chose à faire : des cadeaux à acheter pour Noël, une petite crise à faire parce qu’on a peur d’Ebola, etc. Je caricature, bien sûr, mais que retient-on d’Occupy, par exemple? Quatre-vingt-deux pays auront été le théâtre de campements « illégaux » dans la foulée de ce mouvement de désobéissance civile et d’action directe contre l’austérité à l’automne 2011 – le mot « austérité », ça nous dit encore quelque chose? Les indignés espagnols de 2011 et leurs confrères européens et américains de 2012 se sont-ils retirés dans leurs appartements, déjà? A-t-on oublié Trayvon Martin, Michael Brown, les émeutes de Ferguson? A-t-on déjà oublié qu’aux États-Unis, selon #BlackLivesMatter, un homme, une femme ou un enfant de « race noire » est tué par un policier ou par un membre d’un groupe « d’autodéfense » toutes les vingt-huit heures[7]? Malgré le mot-clic, malgré ses « collègues » #AliveWhileBlack ou #CrimingWhileWhite, la violence raciale demeure. Entend-on encore parler, dans les médias, du #NoMeansNo des étudiantes de l’Université d’Ottawa ou du #YesMeansYes de certains campus américains? Si parfois les mouvements sociaux affectent des changements tangibles – comme dans le cas des lois contre la « revenge porn » adoptées par treize États américains à la suite de la fuite de plusieurs photos explicites de célébrités comme Jennifer Lawrence –, sommes-nous de véritables vecteurs de changements par rapport aux modèles de violence que nous dénonçons par nos mots-clics? Oublie-t-on que quarante-quatre des quatre-vingts suspects arrêtés en lien avec le massacre des étudiants d’Iguala, au Mexique, sont des policiers? Pourquoi continuons-nous d’élire des libéraux et des conservateurs alors que chaque année les raisons se multiplient de descendre dans la rue et de protester contre leurs décisions idéologiques et économiques? Qu’en est-il de toutes ces femmes transsexuelles, de ces jeunes hommes homosexuels, qui sont assassinés ou qui se suicident en masse parce qu’ils et elles sont victimes de violence, d’intimidation, parfois même par leurs propres parents? Combien de temps cela prendra-t-il avant que nous en arrivions à oublier complètement qui sont Leelah Alcorn et Matthew Shepard?
Bref, je suis énervé. Je suis en colère. Le terrorisme me dégoûte, qu’il vise Charlie Hebdo et se réclame de groupes islamistes radicaux ou qu’il porte une capuche blanche, soit chrétien et caresse le rêve d’une Amérique « blanche et pure ». Je suis choqué et énervé et je ne sais trop quoi dire, quoi penser, quoi faire. J’ai besoin d’un peu de temps pour réfléchir à la portée éthique du (de mon) cybermilitantisme. À mon rôle de citoyen. Aux gestes intellectuels et concrets que je peux poser pour être, véritablement, activiste. Je ne crois pas qu’on puisse s’imaginer authentiquement solidaire de la misère en partageant, lorsque cela nous convient bien, quelques articles sur Facebook et en utilisant les mots-clics au goût du jour. Bien sûr, tout le monde ne peut pas « aller au front ». Mais il y en a, de ces penseurs et créateurs, qui s’activent vraiment, dont l’œuvre n’est non pas au service d’une cause, mais « utile », dans une certaine mesure, aux idéologies qu’ils souhaitent défendre. Je crois encore à l’art pour l’art – c’est d’ailleurs une idéologie, en fin de compte –, mais je ne peux que m’incliner devant le travail de collègues qui ne sacrifient ni l’art ni l’idéologie. Catherine Mavrikakis, dont l’œuvre au complet s’oppose à la connerie et au consensus gluant. Mélikah Abdelmoumen, qui défend avec l’énergie du désespoir, dans une prose toujours magnifique, les droits des Roms de France. Mathieu Leroux, qui exige par son travail qu’on remette en question la bien-pensance et ce qu’il convient de dire publiquement sur soi-même. Régine Robin, à contre-courant, qui bégaie magistralement son identité protéiforme. Et tous les autres, que je ne peux nommer ici, mais qui travaillent dans les coulisses du grand cirque médiatique à une sorte de questionnement des fondements de notre société et de notre être-ensemble.
Je suis solidaire de la misère du monde, de ceux et celles qui sont sous le choc, de la civilisation que je veux aussi défendre et construire, des libertés individuelles et des devoirs collectifs, mais je ne sais plus comment m’exprimer. J’ai besoin de prendre mon temps. De réfléchir. Et j’espère que ces notes m’aideront à parvenir à un véritable engagement philosophique, politique, social et littéraire. J’en appelle néanmoins à un grand tremblement de terre, pour reprendre les termes de Rebecca Solnit, qui déclencherait enfin la révolution sociale dont nous avons follement besoin. « It’s always something of a mystery, écrit-elle, why one particular incident becomes the last straw […]. It’s the breaking loose of cumulative tensions, the exhaustion of patience, the work of rage at what has been and hope that there can be, must be, something better. I live in earthquake country, and here we know that the sudden shake-up is preceded by years or decades or centuries of tension. But that doesn’t mean we know when an earthquake will come. » Bientôt, peut-être?
« There are things missing from our history books », scandent Belissa Escobedo, Rhiannon McGavin et Zariya Allen dans leur slam « Somewhere in America[8] ». « We are taught that just because something happened doesn’t mean you are to talk about it, continuent-elles. They build us brand new shopping malls so we forget where we’re really standing, on the bones of the Hispanics, on the bones of the slaves, on the bones of Native Americans, on the bones of those who fought just to speak. » Entre deux frissons, je repense au texte de David Desjardins cité plus haut : « Nous regardons la presse libre mourir à petit feu, puis nous reprenons notre place dans la file à la station-service, au Costco, à l’entrée du Saint-Hubert, au guichet automatique, à la suite d’un statut Facebook qui cristallise un préjugé en trois lignes et auquel nous ajoutons notre petit « like » minable. C’est comme si nous avions oublié de quoi sont constitués les remparts qui préservent ce même confort qui nous fait confondre liberté et conformisme. Et donc, nous laissons ces murs s’effriter, peu à peu, espérant que l’amour fraternel induit par la liberté de consommer nous exemptera de la douleur nécessaire aux débats qui maintiennent une démocratie en vie. »
Je rêve d’un immense tremblement de terre qui démolirait les murs des supermarchés. Pour que nous nous réveillions enfin.
[1] Rebecca Solnit, « Listen up, women are telling their story now », The Guardian, 30 décembre 2014, [en ligne]. https://www.theguardian.com/news/2014/dec/30/-sp-rebecca-solnit-listen-up-women-are-telling-their-story-now
[2]Emmanuelle Walter, Sœurs volées. Enquête sur un féminicide au Canada, préface de Widia Larivière, Montréal, Lux Éditeur, 2014.
[3] Jules Falquet, « Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides : de nouvelles formes de violences contre les femmes? », Contretemps, [en ligne]. https://www.contretemps.eu/interventions/assassinats-ciudad-ju%C3%A1rez-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-f%C3%A9minicides-nouvelles-formes-violences-contre-femm#_ftn15 (page consultée le 11 janvier 2015). Voir à ce propos Julie Devineau, « Autour du concept de fémicide/féminicide : entretiens avec Marcela Lagarde et Montserrat Sagot », Problèmes d’Amérique latine, 2012, volume 2, n° 84, p. 77-91.
[4] Joanna Smith, « Toronto illustrator sends portraits of missing, murdered aboriginal women to Prime Minister Stephen Harper », Toronto Star, 5 janvier 2015, [en ligne]. https://www.thestar.com/news/canada/2015/01/05/toronto_illustrator_sends_portraits_of_missing_murdered_aboriginal_women_to_prime_minister_stephen_harper.html
[5] David Desjardins, « C’est pas un supermarché », Le Devoir, 10 janvier 2015, [en ligne]. https://www.ledevoir.com/societe/medias/428549/c-est-pas-un-supermarche
[6] Ashionye Ogene, « Abandonment of ‘Bring Back Our Girls’ », Al Jazeera, 14 octobre 2014, [en ligne]. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/10/abandonment-bring-back-our-girls-2014101494119446698.html
[7]Selon Black Lives Matter. Statistiques en ligne : https://blacklivesmatter.com/about/
[8]Leur prestation au Queen Latifah Show peut être – et doit être – vue en ligne sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=YshUDa10JYY